25 octobre 2009
Lire (le Roman de la) Rose et voir rouge
Envoyer sur les roses
Le Roman de la Rose est un ouvrage du XIIIème siècle, et pour l’occasion, je vous autorise toute la paranoïa superstitieuse associée à ce chiffre. Il a été écrit par quatre mains, ce qui fait deux mains gauches, soit deux fois plus qu’il n’est tolérable ; Guillaume de Lorris aurait pourtant du savoir qu’il ne fallait pas remettre son travail de De Meun (Jean de son petit nom). La niaiserie du début pouvait passer parce que c’était mignon tout plein, le narrateur qui nous conte comment, en songe, il est entré dans un magnifique jardin et a fait la rencontre de maintes allégories, toutes plus fantastiques les unes que les autres.
N’allons pas voir si la rose…
La rose est naturellement l’allégorie parmi les allégories. Elle est belle, sent bon, mais éloigne par ses épines. Un véritable bouton (purulent) : il suffit d’y toucher et on en fout partout. Le narrateur s’éprend de la rose dès qu’il la voit et est entêté de son parfum. Il va devoir endurer maintes souffrances et surmonter moult obstacles avant de pouvoir l’approcher. Je vais finir par croire que ce n’est pas un hasard si, entre toutes les fleurs, la rose est devenue la métaphore pour la jeune fille aimée : il faut croire que l’amant trouve dans ses épines de quoi aiguillonner son désir – qui s’y frotte s’en pique. Rassure-vous, sa beauté n’aura pas le temps de se fâner, l’amant va la cueillir bien avant, malgré quelques difficultés : « Par cette sente petite et exiguë, ayant rompu la barrière avec le bourdon, je m’introduisis dans la meurtrière, mais n’y entrai pas à moitié. J’étais fâché de ne pas aller plus avant, car je ne pouvais passer outre. Je n’eus de cesse que je n’eusse fait davantage ; je réussis à y mettre jusqu’au bout mon bâton, mais l’écharpe demeura dehors avec les marteaux pendillants ; je fus très mal à l’aise, tant je trouvai le passage étroit ; j’observai que le lieu n’était pas coutumier de recevoir des péages, et que nul avant moi n’y était passé. » Voilà qui est déflorer une métaphore trop mignonne ! Une fois qu’on a ôté les épines, c’est le pied.
Rosa, a, am, ae, ae…
Comme le vase est étroit, je vous ai ôté les feuilles avant de vous offrir le bouquet. Mais voilà, il était en réalité aussi touffu que le problème épineux. On y trouve des dieux (antiques), Dieu (chrétien), et mon Dieu (juron du lecteur qui en a assez) : Antiquité, christianisme et amour courtois médiéval, du trois en un, qui forme une nouvelle trinité païenne.
Alors que Guillaume de Lorris faisait dans l’accumulation et le superlatif, les digressions juxtaposées de Jean de Meun virent au bordel, dont la tenancière serait le Vieille, ancienne prostituée qui jouerait volontiers les proxénètes et prodigue ses conseils comme les lenae des poètes érotiques romains. On trouve de tout : des références à Ovide, Platon, Aristote, Cicéron, un passage sur l’alchimie, un mini-traité de physique sur la réfraction de la lumière par les miroirs ou les comètes… J’ai coutume de considérer les digressions comme croustillantes, encore faut-il qu’elles s’écartent de quelque chose pour mériter leur nom.
Ce roman informe a par conséquent un petit goût d’infini. Le début semble maladroit comme une description de première rédaction : il y a machin, qui est comme ci, machin, qui est comme ça, puis truc, qui est encore plus comme ci, et bidule beaucoup plus comme ça. Les superlatifs s’étouffent, on rajoutera quelques contradictions pour faire glisser. Ainsi, Beauté –blonde, évidemment- est à la fois « grêle » et « grassouillette » ; je ne sais pas s’il faut voir dans le second adjectif qu’elle semblait fort appétissante, ou si la Beauté, toute subjective, est prête à répondre aux goûts de chacun.
C’est répétitif, mais on accorde au narrateur le bénéfice du doute : peut-être le roman va-t-il quelque part. Encore aurait-il fallu pour cela que son premier auteur n’ait pas l’idée sotte et grenue de mourir. Son successeur, après quelques velléités épiques, se trouve las et, indécis quand au cours à donner aux événements, préfère bavasser. Alors pour discuter, ça discute : les personnages exposent leurs théories sans se soucier de savoir s’ils sont écoutés, miment le dialogue, créent des scènes et donnent la parole à d’autres – un comble pour des prosopopées.
Un herbier de pétales flétris
Qu’est-ce qui peut bien plaire dans ce fatras ? Ce doit être le plaisir de gloser, que les universitaires auront en commun avec Jean de Meun, qui adore s’écouter parler. « Je vous en [ndlr : le Parc céleste, où se trouve le « fruit du salut » - renversement méritoire] parle en général, et je m’en tairai aussitôt, car à vrai dire, je n’en sais proprement parler, vu que nulle pensée ne pourrait concevoir, ni bouche d’homme recenser les beautés sublimes, le prix inestimable des choses qui y sont contenues [..] ». Les cinq pages suivantes vous feront comprendre qu’il s’agissait d’une prétérition.
On s’emploiera donc à trouver une cohérence à ce qui n’en a pas, et à considérer les bavardages intempestifs comme les exposés de doctrines sur l’amour qui permettent d’en dresser un panorama aussi complet que possible : la Raison fait l’éloge de l’amour du prochain et de l’amitié ; l’Amour, du romanesque et de la courtoisie ; Vénus, de l’acte sexuel qui permet de perpétuer l’œuvre de Dieu à travers les générations (si on ne fait pas grand cas de l’adultère, on garde tout de même une caution morale supérieure).
Le seul trait commun que je peux trouver aux deux auteurs dont l’un est courtois, raffiné, et l’autre, plus cavalier, c’est l’obsession de la totalité. Le premier essaye de l’atteindre par une énumération interminable, le second en procédant à sauts et à gambades (sans la légèreté de Montaigne, malheureusement), en compilant de fragments d’encyclopédie présentés sous forme de dialogues ou discours rhétoriques. Ou comment déceler dans le roman un genre qui phagocyte tout le reste.
On peut du reste remarquer que le titre n’est pas la Rose, mais le Roman de la rose, celle-ci devenant un complément très secondaire. Le narrateur est bien plus amoureux qu’il n’aime sa bien-aimée, qui n’a aucune personnalité, ni son mot à dire, elle est réduite à sa fonction de but vers lequel tendre. L’amour n’est que littérature et il y a fort à parier que celui-là finit avec celle-ci : sitôt cueillie (ou possédée, selon que vous parlez du comparant ou de la comparée), la rose disparaît dans les brumes du songe écourté : « je cueillis à grande joie la fleur du beau rosier feuillu, et j’eus la rose vermeille. Alors il fit jour et je m’éveillai. » Un point de plus pour Kundera : « Les grandes histoires d’amour européennes se déroulent dans une espace extra-coïtal ». Rose n’est que prétexte à prose – c’est l’amour-poésie.
22:14 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : lecture, livre, décorticage
13 octobre 2009
Oust ! Du ballet !
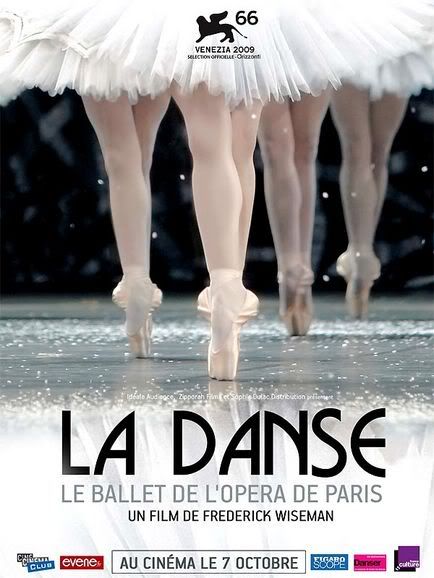
Le bas de l’affiche
Le gros plan sur les jambes des flocons de Casse-noisette, qui constitue l’affiche d’un nouveau documentaire au titre ô combien original de La Danse, n’était pas pour me rassurer sur le potentiel niaiseux du film. Ajoutez à cela une police peu sage– mais qui tire plus sur l’art déco que sur l’anglaise kitsch de la collection de DVD de danse, qui sort en kiosque (après, quand il s’agit d’avoir les Joyaux dans une distribution de rêve pour 12€, on passe rapidement sur le mauvais goût du maquettiste)- j’avais quelques craintes.
Peut-être aurais-je dû être davantage sensible à la composition, les tutus devenant graphiques en créant une zone blanche symétrique à celle où figure le titre. Peut-être cette affiche est-elle plus simplement destinée à faire venir les fétichistes des tutus-diadèmes-pointes, sans pour autant perdre le balletomane pur et dur qui viendra quand même, quelle que soit l’affiche, l’occasion étant trop rare pour être snobée. Mais…, bredouillez-vous, cela signifierait-il que l’amateur de tutus-diadèmes-pointes ne serait pas venu autrement ? J’en ai bien peur. Pour tous ceux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, réjouissez-vous : ne vous fiez pas à l’affiche, c’est un attrape-nunuche.
Un anti-âge heureux
Dès les premières images, le ton est donné : passé un plan général du palais Garnier (on y échappe difficilement), on nous plonge dans les caves du lieu, avec ses couloirs gris et glauques, pleins de tuyaux et de repères tracés à coup de fin de pots de peinture, puis au niveau des machineries (ou de stockage de bobines et autres lourds accessoires non identifiés). Pas d’envolées lyriques sur les toits de l’opéra : tout au plus nous montrera-t-on, avec des images type documentaire animalier sur Arte, la récolte du miel qui y est cultivé. Pas le temps d’entrer dans les alvéoles, la ruche bourdonne en tous sens, de la musique sort de tous les studios, et celle qui s’attarde pour répéter quelques enchaînements de Médée se retrouve enveloppée de bribes de Casse-noisette.
Pourtant, la caméra ne croise personne dans les couloirs, glisse sur les escaliers ne grouillant pas d’élèves comme avant un défilé, et s’attarde sur les bancs vides qui meublaient les vestiaires des petits rats de l’Age heureux.
Les habitués de documentaire de danse souriront peut-être également devant la séquence un peu longue sur la cantine de l’opéra : il y a certes du brocolis, mais avec de la semoule et de la sauce, et sans pomme. Pas de fixette sur le menu diététique pour le rester (menue).
Vous l’aurez compris, le documentaire prend le contrepied de l’imaginaire de la ballerine, et c’est se montrer à la pointe que de repartir du bon pied. Pas d’overdose de pointes, pendant qu’il en est question : hormis Casse-noisette et Paquita, qui sont surtout là pour nous donner à voir le travail du corps de ballet, on fait dans le contemporain, en mettant l’accent sur l’élaboration de l’interprétation qu’il requiert pour les solistes.

L’anti-glamour est poussé jusque dans le classique pur : la sueur n’y est pas luisante. Le traditionnel travelling qui remonte en gros plan des pointes au plateau du tutu prend un tout autre sens lorsqu’il suit les jambes de Pujol (je ne suis plus bien sûre) en répétition : pointes destroy, collants blanc au-dessus de la cheville, sudette qui coupe le mollet et, cherry on top, le short-culotte rose sous le tutu blanc de répétition. C’est ce qui s’appelle en tenir une couche.

[Bon, on n'échappe pas au quart de seconde David Hamilton...]
La voie du sans voix
On peut trouver que le documentaire met du temps à démarrer, mais force est de capituler : on attendra en vain une voix off. La caméra filme comme un œil omniscient derrière lequel s’efface le caméraman muet (au contraire de Nils Tavernier qui posait des questions tous azimuts) et que l’on oublierait presque si le montage ne rappelait pas la subjectivité d’une présence. Pas d’enième compte du nombre de danseurs dans la maison, du parcours du quadrille jusqu’à l’étoile, des plaintes sur la fatigue physique compensées par des yeux brillants ouvrant sur des soupirs d’enthousiasme. Mais pas d’indication non plus : on ne sait pas qui danse, ni quoi, qui fait répéter, quel nom porte ce chorégraphe…

Les seules « explications » que l’on obtienne, c’est par le truchement de Brigitte Lefèvre. Mais là encore, il faut souligner qu’elle apparaît d’abord au téléphone et qu’elle ne s’adresse pas plus à la caméra par la suite. Elle est prise dans son rôle de directrice de la danse, qui se doit de recevoir les partenaires (l’organisation de la réception des mécènes américains lors de la venue du NYCB vaut son pesant de cacahuètes – « et que peut-on prévoir plus particulièrement pour les « bienfaiteurs » ? Ce sont les plus de 25 000 dollars. »), les chorégraphes (je ne sais pas qui c’était, mais il ne comprenait visiblement pas la différence de statut entre les étoiles et le corps de ballet) et les danseurs (crise de fou rire devant la piquante danseuse –who ?- qui vient refuser le pas de trois de Paquita, parce qu’elle est déjà bien trop distribuée et que bon, elle n’a plus vingt-cinq ans).
Frederick Wiseman ne prend pas la parole, mais il ne la donne pas non plus : on évite les approximations de danseurs qui ne sont pas rompus à la parole et on les laisse s’exprimer de la manière qui leur convient le mieux : par le geste (dansant ou pas, selon qu’il s’inscrit dans la chorégraphie ou dans l’attitude lors d’une répétition). Alors que souvent dans les documentaires la caméra glisse d’une salle à l’autre et prend la fuite sitôt la variation finie, Frederick Wiseman prend le temps (et en 2h40, vous avez le temps d’avoir mal aux fesses – à ce propos, Palpatine, ton titre était déjà pris : « C'est long mais c'est beau. Rien n'est aussi délicat à filmer que la danse, et Wiseman le fait somptueusement. » Anne Bavelier, au Figaroscope) de filmer les tâtonnements et même l’épuisement (Marie-Agnès Gillot allongée/terrassée après un long duo).
En habituant les danseurs à sa présence discrète (Frederick Wiseman a tourné pendant douze semaines), et en ne les délogeant pas de leur mode d’expression qui leur est propre, la caméra évite la pose. Grâce à ce témoin peu indiscret, on a le droit à de savoureux dialogues. Le premier à avoir fait rire la salle est le désaccord sur la descente par la demi-pointe entre Ghislaine Thesmar et Lacotte (les noms grâce à Amélie).
Mais j’ai de loin préféré les commentaires lors de la répétition sur scène de Paquita. La caméra ne quitte pas la scène, mais, exactement comme si l’on était installé dans l’obscurité de la salle, on entend deux voix (dont une doit appartenir à Laurent Hilaire) qui commentent tout. Et c’est croustillant. On sent le maître de ballet généreux et énergique, mais dont l’enthousiasme, sous l’effet de la fatigue, commence à dégénérer en un état second joyeusement hystérique. Tout haut : « non, les garçons, non, les deux lignes, écartez-vous, vous voyez bien qu’il n’a pas la place de passer ! non, mais…. Pff. On recommence… (un temps)… il va bien falloir que ça la fasse, de toute façon. ». Un temps. Tout bas, dans un soupir : « putain… ». Puis viennent les commentaires réjouis sur Mathilde Froustey : « -Mais c’est quoi ce short rose ? – Elle est arrivée en retard. –Oh… » ; sur un garçon : « facile pour lui, c’est presque indécent » ; et deux filles : « Ah ! Celles-ci, c’est formidable, elles l’ont fait tellement de fois, qu’on les branche ensemble, et hop, ça marche ».
Variations pour un balletomaniaque
En l’absence d’indications, ce documentaire est un terrain de jeu rêvé pour le balletomane qui, interloqué un quart de seconde d’entendre « Ton pied, Létice ! », s’écrit aussitôt en son fort intérieur : « Laetitia Pujol ! » ; le degré de balletomaniaquerie étant inversement proportionnel au grade du corps de ballet. Aux nombreux points d’interrogation qui me restent, j’en déduis que je suis bien loin de la névrose. Après la devinette de l’identité grâce à la façon de danser, au visage et éventuellement au prénom prononcé par le répétiteur ou le chorégraphe, les tics de ces derniers constituent une nouvelle source d’amusement. La plupart du temps en anglais (avec ou non accent russe ou autre), les indications sont doublées de broderies musicales très variées « ta da dam, di da dam, pa da dam, ta da daaaaam » (les voyelles ainsi étirées signifient « bordel, sur le temps, l’accent ! en mesure les filles ! »), « la la na na na la laaaa na la na naaa » « bim bim bim didididim » et plus contemporain « chtiiiiiii yaak, chti papapapapam, chti chtouu dou chti tchi tchiii ya ».
Les choix des solistes filmés seront toujours discutés. Pour ma part, ça donnerait quelque chose comme ça : Marie-Agnès Gillot crève l’écran, thanks a lot ; clairement pas assez de Leriche et Dupont, c’est une honte ; plus de Pech, de Romoli et de Dorothée Gilbert n’aurait pas nuit ; trop de Cozette, et légèrement trop de Pujol (pas intrinsèquement, plutôt par rapport à ceux qu’il n’y a pas) ; j’aurais bien aimé voir Myriam Ould-Braham en répétition ; où sont donc passés Karl Paquette, Delphine Moussin et Eleonora Abbagnatto ?

Côté chorégraphes, il va falloir que je découvre Sasha Waltz (si c’est bien sa version de Roméo et Juliette que danse Dupont sur la scène inclinée), et les extraits de Genus (si ce sont bien les justaucorps bleus avec des espèces de colonnes vertébrales blanches dessus) m’ont donné une furieuse envie d’aller voir du Wayne McGregor (au programme cette année).

Hors des coulisses, le travail
Le frisson du hors-scène n’est pas le seul ni même le principal ressort de ce documentaire : les coulisses sont bien moins le champ d’investigation de Frederick Wiseman que le studio, et si l’on y parle beaucoup, ce film demeure étrangement muet. Quoique… muet comme une danse, parlant à sa manière, par ses angles de plan, son montage, son mutisme même. Il parvient à renverser la tendance du spectateur à envisager le « hors-scène » d’après le spectacle auquel il assiste, vers la perspective du danseur dont le quotidien culmine dans la représentation (sommet, mais finalement assez ponctuel dans le cheminement journalier). Il montre que le travail de la danse n’est pas seulement un résultat (au sens où un élève rendrait ses travaux pour que son professeur les corrige), mais d’abord un entraînement de longue haleine (on dit bien que le bois d’une charpente travaille) et aussi un emploi (Garnier pour bureau).
Frederick Wiseman : « Tous les gestes des danseurs sont du travail, de l'entraînement dès l'âge de 6 ou 7 ans, pour manipuler le corps et arriver à ces choses si belles. Et puis, lorsqu'ils sont plus âgés, ils ont souvent des maladies très liées à leur carrière. Dans un certain sens, c'est une lutte contre la mort, parce que c'est quelque chose de très artificiel. Et on sait que ça ne dure pas, parce que le spectacle est transitoire, mais également le corps. Et c'est un privilège de regarder les gens qui se sont consacrés à cette vie, et ne peuvent pas gagner cette bataille contre l'usure et la mort, ou alors pour très peu de temps. Cela m'intéresse beaucoup : la danse est si évanescente... »
Le travail comme emploi

Les séquences sur les petites mains qui brodent les costumes, la directrice de la danse qui gère l’administratif en relation avec les danseurs, ou encore les hommes de ménage qui passent dans les loges avec un aspirateur sur le dos ne sont donc pas inutiles en ce qu’elles permettent de replacer les danseurs dans un contexte qui n’est pas seulement artistique. Il ne s’agit pas de démystifier quoi que ce soit, mais de réinscrire les danseurs dans « la grande maison » (au sens très littéral : on voit des ouvriers replâtrer les fissures ou passer un coup de peinture sur les murs) et, plus largement encore, dans la société actuelle : ils sont salariés, et la question des retraites se posent pour aux aussi –d’autant plus qu’ils partent à 43 ans- ; j’ai été bêtement surprise lorsque Angelin Perljocaj explique que la main de Médée, qui passe sur le cou du Jason est à mi-chemin entre la caresse et la coupure, « vous savez, comme ces personnages dans Matrix qui ont des trucs au bout des mains… ils voudraient aimer mais ne peuvent pas ». Et Romoli de renchérir « Edward aux mains d’argent, quoi. » Ils continuent d’exister hors scène et hors opéra, mais rien à faire, le hors-contexte fait toujours un drôle d’effet.
Le film montre la danse comme un emploi, l’Opéra comme une administration. Dès lors, que les prises extérieures de Garnier et Bastille ne soient pas esthétisées, mais pleines de bruit, de pluie et de circulation, les intègre d’autant plus au parti pris du documentaire qui ne trace qu’une ligne des feux de la rampe à ceux de la circulation. Ne circulez pas, y’a à voir !
Le travail comme modelage du matériau qu’est le corps
Une respiration essoufflée vaut mieux qu’un long discours, et le temps de filmer une répétition, celui de faire parler les intéressés. C’est la première fois qu’un documentaire me donne à sentir ce que pouvait entendre Aurélie Dupont lorsqu’elle disait qu’une étoile était très seule. Ce qu’on voit habituellement des répétitions (temps d’une variation, ou répétition plus longue, mais parmi les dernières, c’est-à-dire quand les étoiles sont réunies avec le corps de ballet) ne laissait pas imaginer le triangle maître de ballet-étoile-miroir, avec le premier qui finit par laisser le silence se refermer sur le face-à-face des deux derniers. La danseuse se retrouve happée par son image, ainsi que le suggère le plan sur la jonction de deux miroirs où le corps tronqué du danseur vient à disparaître après s’être abi/ymé. La personnalité des maîtres de ballet prend d’autant plus d’importance ; autant Clotilde Vayer semble de glace, autant Laurent Hilaire paraît à même de fendiller cette espèce de solitude.
A ce niveau, mis à part quelques corrections techniques, les indications ne sont plus que des conseils et, une fois, dispensés à l’étoile, celle-ci est seule en scène. C’est d’ailleurs là qu’on a confirmation de ce qu’Emilie Cozette est plus une bonne élève qu’une brillante étoile : il faut que Laurent Hilaire lui décrypte chaque geste de la chorégraphie de Médée, qu’elle peine visiblement à s’approprier…
Sur fonds de cette solitude, la fatigue des corps couverts de pelures diverses et avariées ressort bien plus que par un plan ciblant une douleur particulière. Le grand classique du pied plein d’ampoules fait grimacer, mais n’a rien de commun avec la fatigue générale d’un corps fourbu d’être tant sollicité.
Le travail comme résultat
Chronologie, même lâche, oblige, on va plus ou moins de la répétition au spectacle abouti, sur scène. Mais le documentaire est tel que plutôt que de garder en mémoire le travail qu’il y a « derrière », on continue à voir dans la représentation le travail toujours inachevé du corps qui cherche continuellement le mouvement. Wiseman a compris que le spectacle ne se laisse pas filmer comme tel, qu’il y a besoin de tourner autour et de zoomer tout comme l’œil suit tel ou tel détail au gré de ses caprices (condition sine qua non pour ne pas mourir d’ennui au bout de cinq minutes – même si l’on a parfois le désagrément de constater que l’on n’a pas du tout la sensibilité du cinéaste, et que l’on aimerait toujours que la caméra soit dans le champ de ce qu’elle exclut), d’où que ses échappées hors scène vers les tringles en pleine chorégraphie ne sont pas du tout gênantes. Il en résulte que le mouvement est pleinement rendu. Et l’on se dit qu’au final, un titre banal mais dépouillé n’est pas si mal choisi pour ce film brut – ce n’est pas une pépite, pas d’ « étoile » dans le titre- qui se place continuellement en retrait pour aller au fonds des choses. Apre ou pudique, presque rien.
16:18 Publié dans Souris de médiathèque, Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : film, cinéma, décortiquage, ballet, danse, garnier, opéra, chorégraphie
12 octobre 2009
Les primitifs flamands et Cie au musée Jacquemart-André
On arrive les joues bien roses pour voir les Flamands, après avoir fait le pied de grue pendant plus d’une heure devant le musée Jacquemart-André qui expose (une partie de) la collection Brukenthal. Quelque chose dont j’étais curieuse sans pour autant y rien connaître. Je ne suis pas certaine d’avoir saisi le véritable principe d’organisation de l’exposition, alors plutôt qu’un compte-rendu pudding comme j’en fait depuis quelques temps, voici plutôt un assortiment hasardeux de quelques sablés à grignoter dans le parc Monceau, qu’on a rejoint en sortant, par la rue Rembrandt, coïncidence poétique. Voici ce qui peut passer par la tête d’une souris devant des tableaux et ne doit pas nécessairement être attribué aux tableaux (quand tu cognes ta tête contre une cruche et que ça sonne vide…)
Les paysages n’ont jamais été ma tasse de thé, je les trouvais très bien au rang d’ornements de portrait dont on nous apprend qu’ils se sont progressivement démarqués, jusqu’à devenir un genre autonome (j’ai comme un énorme doute sur la grammaticalité de ma phrase, mais une flemme plus énorme encore de trouver une tournure élégante et correcte).

[Paysage montagneux avec un moulin Jodocus De Momper]
La profondeur par la couleur… souvenez-vous en : terre à terre n’est pas gris mais marron, et pour idéaliser tout ce qui est dans le lointain (montagne eu loin, horizon de la mer, ciel, yeux d’un inconnu), c’est le bleu. Glacier, pour statufier tout mouvement et faire entrer votre sujet dans l’éternité.
* * *

Fort heureusement, Bruegel a eu la bonne idée de peupler ses paysages de multiples scènes de genre miniature, et c’est beaucoup plus divertissant à regarder. Le massacre des innocents propose ainsi quelques variations sur les moyens de s’étriper. Le ciel est bien bleu, la neige blanche malgré le sang, c’est coloré, c’est si vif et joyeux que c’en est terrifiant. De loin, verriez-vous grande différence avec le Paysage à la trappe aux oiseaux de Pieter Brueghel le Jeune (ci-dessous)? (si quelqu’un pouvait m’expliquer pourquoi une trappe dans le titre… ça m’intrigue fort) Cette indifférence du paysage au massacre me rappelle Malraux et ses détails anodins (un vol de pigeons sur le square ensoleillé, un verre de vin…) qui paraissent presque obscènes au milieu des combats.

* * *
Pas vraiment un sablé mais plutôt une galette de beurre : L'homme au chaperon bleu de Jan Van Eyck, aussi célèbre que petit. Palpat’ a eu une suprise semblable à celle que j’avais eu devant la Laitière de Rembrandt (qui fait à peine un format A4 if memory serves).
* * *

[La visite chez le médecin du village de David II Teniers]
On retrouve vite ses vieux réflexes enchanteurs qui font voir un alchimiste à la place d’un médecin. Tant qu’on ne sait pas que ce dernier se livre à une analyse d’urine, on peut être fasciné par le reflet du verre de la fiole.
* * *

La Sainte Famille de Jacob JORDAENS, ou la naissance du film d’horreur. Franchement, regardez-moi l’ombre démesurée de la main de la femme éclairée en contre-plongée par le cierge !
* * *

[Trois femmes et un enfant : esquisse pour l'été et pour le bac de Jacob Jordeans]
[désol:ée pour l'affreux cadrage vert]
La juxtaposition des trois études me plaît bien. Les femmes ne sont évidemment pas proportionnées les unes aux autres, mais on s’élance volontiers dans cette espèce de rêverie. La main à gauche, qui plonge hors du cadre. Le chapeau retenu. Le téton qui semble posé sur le tissu. Puis je ne cesse d’être surprise de ce que le front jaune, la joue rose et le duvet de barbe blanche réussissent à faire le portrait d’une femme sans la transformer en père Noël alcoolique avec la jaunisse.
* * *

[Nature morte d’apparat à la colonne de Joris Van Son]
Au milieu de natures mortes glauques de couronnes de fleurs au-dessus d’une sorte de stèle sculptée (mais c’est la dénonciation des vanités, voyons ! Ne cueillez donc pas le jour, il est si vite fané…), j’en ai trouvé une qui se plaisait un peu plus, avec son coquillage vide mais brillant (all that glitters… vide, vain), ses grains de raisins transparents et ses cerises déjà confites. J’ai été un peu déçue de voir que le coup du reflet n’était pas particulier à la chouette nature morte que j’avais remarquée en Italie (mais celui de la galerie des offices était mieux, quand même). C’est curieux tout de même : la nature morte fait tout son possible pour ne pas mériter son nom. Si l’on s’y arrête un peu, chaque élément semble s’efforcer de prendre vie depuis son bout d’éternité entoilée. On y trouve même des éléments vivants non périssables – bien que le papillon soit éphémère, je vous l’accorde. Le pauvre est d’ailleurs comme arrêté dans sa course, épinglé avant d’avoir fait son temps (l’excès de vitesse n’est pas toléré dans une still life). Au final, cette animation immobile, engluée, a quelque chose de glauque. On ira lire les explications symboliques sur le site de l’expo.
* * *
Dans la salle des peintures italiennes de la collection permanente, on a pas mal médit des Christ-crevettes (le poisson, encore, c’est réglementaire, mais la crevette…) - petites sirènes pour l’adaptation Walt Disney. Le pauvre nouveau-né devait être très mal emmailloté dans ses bandelettes : le martyr commence tôt. Les représentations de Jésus encore dans les bras de la vierge Marie lui font souvent une tête austère, adulte, tout à fait angoissante sur un corps de bébé – d’où qu’un tableau de l’expo, dont je n’ai pas retrouvé pas le titre mais seulement un détail, était surprenant : Jésus y avait une tête de bébé, et le couple mère-enfant avait l’air si serein qu’on ne se serait pas douté qu’il s’agissait d’une peinture religieuse si elle n’avait été classé dans la salle du même nom.
* * *
Des collections permanentes, je grappillerai le Portrait de la comtesse Skavronsky par Vigée Le Brun. Je ne sais pas si c’est d’avoir vu le Genou de Claire ou si l’analyse du Verrou de Fragonard par Daniel Arasse a laissé quelque trace dans ma cervelle de poisson rouge, mais les genoux de la comtesse me semblent bien plus indécents que sa poitrine qui semble n’en être que la réduction.
* * *
Surtout, je suis restée en suspends devant ce tableau de Rembrandt. La silhouette noire du premier plan est tout à fait fascinante : le personnage qu’elle occulte provoque visiblement une vive impression sur le personnage du milieu, le seul éclairé ; impression d’autant plus frappante pour le spectateur que nous ne savons rien de la silhouette noire qui se dérobe, et semble disparaître dans l’obscurité ambiante du tableau, une fissure dans le premier plan éclairé. Comme mon inculture religieuse n’a d’égale que mon inculture musicale et cinématographique, je ne me doutais bien évidemment pas qu’il s’agissait d’une scène religieuse, à Emmaüs, où des pèlerins reconnaissent le Christ après qu’il ait ressuscité (ça, c’est du rebondissement à faire pâlir les scénaristes de Hollywood). Parce qu’il vaut parfois mieux se taire et laisser parler ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire, je vous conseille d’aller chausser quelques instants les lunettes rouges d’un amateur d’art.
* **
Parce que des âneries ne traversent pas forcément l’esprit de tout le monde durant une expo et que les miennes sont fort peu pertinentes d’un point de vue esthétique, voici le site de l’exposition, fort bien fait, avec ses petites notices sur les œuvres et la souris qui devient loupe lorsqu’on la passe sur les reproductions (faut croire que c’est le propre de la souris de grossir les détails). J’ai découvert qu’on pouvait télécharger la visite de l’expo sur mp3 : c’est pas délire ça ?
22:16 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : exposition, peinture
04 octobre 2009
(500) jours ensemble
[Spoilers]
Les parenthèses du titre sont curieuses, comme si le nombre de jours était incertain ou insignifiant par rapport au fait d’être ensemble. Il s’avère pourtant n’être pas à débattre ; on comprend vite que les parenthèses transforment les trois chiffres en compteur à avancer ou remonter le temps, et ainsi naviguer dans ce film qui parle d’amour sans pour autant être une histoire d’amour, ainsi que nous avertit l’affiche. Ecrit en blanc sur jaune, ce pourrait bien n’être pas sérieux : toutes les bonnes comédies romantiques fonctionnent comme anti-conte de fées. Méfiance, donc. Ou plutôt, toute confiance, en très bon public de ce genre, j’emmène ma grand-mère voir « une comédie romantique » américaine.
Et pourtant, le film tient ses promesses : loin d’écarter les passages obligés (fascination pour les yeux, maladresse du garçon, intérêt de la fille contre toute attente, jeux complices idiots, balade chez le disquaire etc.), il les intègre, non tant pour les renverser, que pour les inscrire dans un cadre plus large qui en interroge la portée. Ce qu’il s’emploie à déconstruire, c’est l’idée de destin, le fameux « parce que c’était lui, parce que c’était moi », auto-justification spécieuse du coup de foudre.
Le personnage de Summer (Zooey Deschanel) est un premier élément, dans la mesure où cette fille, contrairement à Tom (Joseph Gordon-Levitt) qui va en tomber amoureux, ne croit pas au grand Amour (elle grimacerait de la voir écrit avec une majuscule, pour vous donner le ton), à la possibilité de trouver l’homme de sa vie et autres grands chevaux sur lesquels grimper pour que tourne manège. La comédie romantique de base vous la ferait changer d’avis pour les beaux yeux du gars, hop là, c’est encore plus beau quand on a cru que ça ne marcherait pas ; c’est là que le film aurait « failli ».
Déconstruire l’idée de destin n’est pas facile, s’il est vrai que ce que l’on fait pour s’en détourner est précisément le moyen qu’a choisi le destin pour nous y faire tomber (cf. Œdipe). C’est pour cela que la comédie romantique, qui s’ingénie à s’écarter du couple toujours déjà défini du prince et de la princesse, parce qu’il fait s’embrasser les contraires et qu’ils finissent fatalement heureux (mariés et envahis d’enfants ou non, seule concession à la modernité), n’est qu’un conte de fées, quand bien même elle proclame le contraire. Le tonnerre des débuts orageux est justifié par le coup de foudre final – c’est vrai, quoi, le tonnerre précède toujours l’éclair.
Comment le film s’y prend-t-il alors pour renverser les codes d’un genre qui fonctionne sur le renversement ? Comme toujours, tout est question de forme, bien plus que de contenu (les conceptions de Summer sur l’amour auraient très bien pu être renversées par le coup de foudre). La meilleure trouvaille de ce film, d’ailleurs mise en avant dès le titre avec les parenthèses, c’est bien la non linéarité chronologique. Loin de brouiller les repères, les va-et-vient dans le temps de cette relation en donnent l’ossature et empêchent qu’elle ne soit qualifiées d’histoire d’amour. Très rapidement, on apprend que Summer et Tom n’étaient pas a priori faits pour s’entendre, qu’une histoire a pourtant démarré et qu’elle est au point mort. Le suspens n’est pas placé dans la question de savoir s’il va la récupérer (on comprend vite que non – puis cela ne ferait que redoubler la comédie romantique, déjà présente avec la situation initiale), mais dans l’enquête qui devrait nous apprendre ce qui clochait. Là finit la comédie romantique et commence le « film qui parle d’amour ».
La répétition, en ôtant à la linéarité chronologique tout sens prédéfini, est un procédé très efficace : un moment vécu fournit un indice pouvant se transformer en « preuve » une fois intégré à une hypothèse d’interprétation. Par exemple, le motif de la balade chez le disquaire : donné seul, il est l’occasion d’un désaccord mineur (goût musicaux différents) par rapport à la sortie à deux qui en permet l’expression ; répété, il devient un motif de l’obsession de Tom pour Summer ; enfin, sur recommandation d’une gamine qui se pose comme expérimentée et dont on ne sait pas d’où elle sort, réintégré dans un contexte plus large, (Summer traîne des pieds, et décide ensuite de rentrer chez elle pour cause de fatigue – elle ne prétexte pas la migraine, mais c’est tout juste), il est révélateur du comportement de Summer à l’égard de leur histoire. Dès lors, force est de reconnaître que le non-respect de la chronologie ne conduit pas au désordre, mais a sa propre cohérence ; la linéarité, parce qu’il y en a bien une, est celle de la compréhension progressive de sa situation par Tom. On pourrait parler de désillusion, mais il faudrait alors prendre garde de préciser que c’est à propos de lui-même, et non de Summer, qu’il devient lucide.
Tom a beau avoir très clairement senti les points que Summer a mis sur les « i », il ne se raconte pas moins des histoires. Une fois que la répétition de certaines scènes en a élargi le champ, on comprend que l’histoire des premiers jours (enfin premiers temps, laissons-le rêver un peu, tout de même) est le film que s’est fait Tom, qui a réalisé son propre montage à partir d’une sélection de phrases et d’épisodes qui réunit ensemble devenaient significatifs et encourageaient à penser que leur relation pouvait devenir une histoire. Qu’il se soit « fait des films » est rendu évident à deux reprises : lorsque, invité chez Summer après leur séparation, l’écran est divisé entre « les attentes » et « la réalité », avec à gauche le scénario comédie romantique (regards, discussion, baisers de préliminaires) et à droite ce qui le contrarie (attention portée aux autres, silence, solitude dans la foule de la fête) ; puis lorsqu’il va cacher ses pleurs dans une salle obscure et que s’étant endormi, il se retrouve le héro malmené de vieux films noirs et blancs. Dans ces deux cas, il est explicite qu’il s’agit d’une construction personnelle, et il n’est pas anodin que cette évidence n’apparaisse qu’après l’histoire d’amour. Cette dernière n’en était en effet qu’une forme implicite.
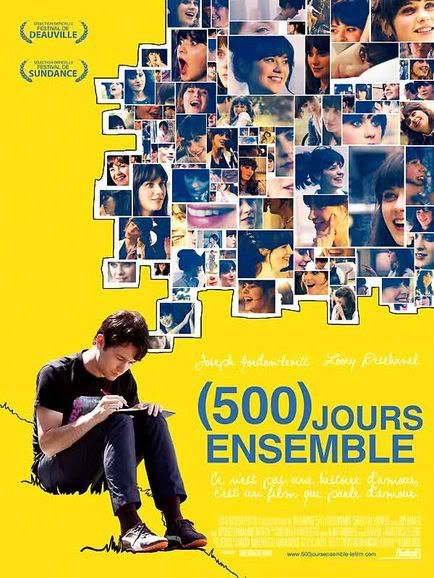
[A ce titre, l’affiche est assez réussie : l’espèce de bulle de photos de Summer qui semble reliée à un Tom pourvu d’un cahier semble suggérer qu’il écrit son journal. La déséquilibre entre une seule grande photo de Tom, et Summer fragmentée en de multiples vignettes n’est pas seulement là pour donner à chaque acteur une place d’égale importance. La cohérence du film qui donne pourtant une image kaléidoscopique de Summer, est à trouver du côté de Tom : c’est lui qui écrit son histoire, dont Summer est un personnage avant d’en être la co-auteur.
A cela s’ajoute les couleurs : des couleurs primaires, c’est le rouge (le magenta, si vous voulez chipoter) et sa symbolique en gros sabots qui est exclue. Comme dans l’affiche des Chansons d’amour, vous noterez. Visiblement, je ne suis pas la seule à l’avoir remarqué. ]
En somme, il n’y aurait pas eu d’histoire d’amour parce que Tom s’est raconté des histoires. N’allons pas trop vite en besogne (je sais, je suis gonflée de dire ça au milieu de ma deuxième page Word, mais vous commencez à être habitués –sinon vous ne lisez pas même cela). Toutes les histoires ne sont pas bonnes à jeter ; certaines, au contraire, qui relèvent du jeu, créent une véritable complicité entre les deux énergumènes : le petit délire de jouer à avoir un « chez soi » commun chez Ikéa est de cet ordre. Mais cette historiette est partagée, ce que n’est pas l’histoire d’amour, construite par Tom seul.
Cette autopsie d’une histoire d’amour ratée ne débouche pas sur histoire romantique depuis le coup de foudre jusqu’à l’indéfini du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » (ça me semble contradictoire dans les termes, mais passons) versus lucidité cynique « on ne se raconte jamais que des histoires : l’histoire d’amour n’existe pas », mais donne l’ossature d’une relation amoureuse, montre que ce qui importe en premier lieu dans une histoire d’amour, c’est qu’elle soit une histoire, et une histoire écrite à quatre mains. Pas de bricolage avec une réalité dont on délaisserait les aspects déplaisants, mais construction volontaire d’un sens. Une illusion constitutive, dont il ne s’agit pas de se débarrasser, mais de prendre conscience. Après, paresse aidant, on donne moins au sens celui d’une signification que celui d’une linéarité… – fate is back !
Il est finalement beaucoup plus instructif qu’il ne se passe « rien ». Non que rien ne se passe, mais que la chose attendue ne survienne pas. Vous me direz peut-être que c’est parce que je suis en train de découvrir Rohmer, mais ce qui aurait pu avoir lieu mais ne s’est pas produit est formidable, à condition bien sûr que la potentialité ait été effectivement possible (le premier qui me renvoie à l’argument du Dominateur ou à l’être en puissance d’Aristote, je l’explose) : c’est la sensualité de la main de Vermeer qui ne caresse pas celle de la jeune fille à la perle ; c’est l’exposition en vitrine de la collectionneuse ; c’est la nuit chez Maud, où l’on ne peut pas dire qu’ « il ne s’est rien passé » sans pour autant qu’il se soit passé quelque chose ; c’est la fin incertaine de Square de Duras… (500) jours ensemble déjoue lui aussi les attentes du spectateur, ce destin ex machina.
Si c’est lorsqu’il ne prend pas que l’on voit comment fonctionne le destin, son échec ponctuel ne signifie pas la démonstration de son inexistence. Il est déplacé, voilà tout. Et puis, il faut que la déception (des attentes) ne soit pas trop amère : alors on laisse à un bel inconnu le soin de passer la bague au doigt de Summer (qui se met à croire au destin, tout simplement parce qu’elle a construit une histoire cohérente qui vient justifier ses choix et à laquelle elle a donné ce nom), et comme après la pluie vient le beau temps, après Summer, on propose Autumn à Tom. Comme quoi les beaux jours ne sont pas question de météo. Du coup, exit le destin, qui laisse la place au hasard. *Kundera power !* C’est formidable le hasard : c’est exactement la trame des coïncidences que l’on choisit de transformer en destin ou non. Cet emploi est si tentant que l’on ne parle guère du hasard que pour désigner la forme originelle du destin. Aristote vous le confirmerait, lui qui définit (avec la simplicité retorse qui est la sienne) le hasard comme « cause par accident concernant celles parmi les choses en vue de quelque chose qui relèvent du choix réfléchi ». Bref, on ne pourrait parler de hasard que lorsque la chose aurait pu se produire suite à une décision. Il n’y a guère que Kundera pour penser la hasard jusque dans son insignifiance : il parle alors de « coïncidence muette » (il y a un mémoire là-dessus à la bibliothèque de P3, il faut que j’aille le lire !).
A une autre échelle, le déplacement du destin serait celui du film tout entier, comme quelque chose réalisé à partir d’un matériau de récupération, ainsi qu’en témoigne le générique et sa délicate dédicace à l’ex du réalisateur qu’il qualifie de « connasse ». Cette dédicace, tout en prenant le contre-pied de ce que toute ressemblance avec des personnes réelles est le fruit du hasard (encore lui), indique que le film est ce qui vient donner un sens à un échec. Le sens à trouver logerait donc bien moins dans un quelconque destin que dans la création (du film pour le réalisateur, des plans d’architecture pour Tom).
Voir tout se ramifier, ça m’excite terriblement le neurone. Je dérive sacrément, avec ça. Contrairement à mes élucubrations, le film est drôle. Le film par son montage, non par ses dialogues, ce qui est plus fin (maintenant, si c’est Hugh Grant et sa tête de boulet craquant, même une réplique comme « This one is plastic » lancée à la véritable catastrophe de fille qui vient pour arroser ses plantes dans le Come back peut me faire marrer – je suis très bon public, ne l’oublions pas). Les juxtapositions offrent des contrastes qui font sourires : par exemple lorsque Tom compare sa vie sentimentale avec ses amis qui n’ont rien à lui apprendre puisque l’un est avec sa copine depuis la 5ème et que l’autre n’a pas vu une fille de près depuis environ la même époque. Et puis, il y a des fous rires désamorcés en sourire, comme lorsque la voix off annonce qu’il y a deux catégories de personne dans la vie ; on attend un truc puissant un peu concept et là, on retombe dans l’évidence même : les hommes et les femmes, Tom appartenant à la première catégorie, Summer, à la seconde. S’ils finissent (commencent, plutôt) par sortir ensemble, c’est simplement parce que les schémas de séduction sont déjà en place. Et la fiche descriptive de Summer par un arrêt sur image le confirme avec humour : taille, moyenne ; poids, moyen ; pointure, légèrement au-dessus de la moyenne.
En somme, une comédie qui n’est pas romantique mais qui parle d’amour sans faire d’histoire. Ce blogueur a raison de parler de « grand petit film », parce qu’il est très bon, l’air de ne pas y toucher…
22:47 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : film, cinéma, décorticage



























