27 juin 2014
Les bons sentiments, les bons sauvages, et cetera, et cetera
The King and I, c'est le roi du Siam et moi, institutrice anglaise venue pour éduquer ses femmes et ses enfants, c'est-à-dire moi, spectateur occidental venu assister à une comédie musicale précédée par son excellente réputation. Le spectacle est effectivement de fort bonne tenue : les costumes sont chatoyants, les décors efficaces et les danses sympathiques, tout comme les acteurs-chanteurs qui ne font pas les choses à moitié – la louange unanime vous dira cela beaucoup mieux que moi. Mais voilà : cette attendrissante Mary Poppins en Thaïlande finit par me mettre mal à l'aise lorsque je comprends que son effronterie de femme qui ne s'en laisse pas compter trouve sa source dans un aplomb moralisateur. Le féminisme même du personnage devient une émanation du colonialisme : le bon sauvage (même le plus grand des bons sauvages, leur roi) est si peu moderne que n'importe quel homme occidental (même une femme, simple institutrice) est plus éclairé que lui.
Heureusement pour lui (ou pour nous), le bon sauvage est bon : c'est-à-dire qu'il a du cœur mais aussi, et surtout, qu'il accepte de se laisser occidentaliser. Même si cela ne se fait pas sans heurts, le roi sait ce qui est bon pour lui et pour son pays : il fait instruire ses enfants (même s'il est inacceptable que le Siam soit si petit sur le planisphère venu d'Angleterre) et ses femmes (qui ont la décence de rester obéissantes), les habille à l'européenne pour faire bonne impression auprès de ces barbares d'Anglais qui voudraient mettre le Siam sous protectorat, et assouplit juste assez l'obligation de se prosterner devant lui pour que cela devienne un élément comique récurrent, tout comme le tic de langage latinisant qu'il emprunte à l'institutrice et dont il ponctue chacune de ses phrases, et cetera, et cetera.
Le divertissement du second acte, qui vient comme un cheveu sur la soupe, est chargé de montrer le triomphe des Lumières, aveugles à l'idiosyncrasie d'une autre culture que la leur : le vernis européen est respecté avec une adaptation express de La Case de l'Oncle Tom (caution express d'anti-esclavagisme donc, causalité express, d'anticolonialisme), les tenues traditionnelles se donnent à voir comme des tenues de scène et les chœurs traditionnels, qui déclenchent les rires par leurs anaphores suraiguës, commentent moins l'action que la perspective d'une autre culture, qui réduit la leur à du folklore. Plus que la vision occidentale sur non-occidental, ce divertissement donne à voir la vision de l'Occidental sur la vision qu'il espère que le non-Occidental a de lui. Qu'il espère... que dis-je ? Qu'il est persuadé que le non-Occidental a de lui : les approximations des autochtones ne sont sources de comique que parce qu'on présume qu'elles résultent d'une certaine maladresse et non d'une résistance culturelle. La méprise est toujours d'actualité lorsqu'on la débarrasse de sa condescendance coloniale : on minimise totalement l'altérité des valeurs d'une société à partir du moment où elle a adopté les symboles de la nôtre, méconnaissant et les fondements symboliques de notre société et leur absence de structuration dans d'autres (ces symboles ne sont pas partout structurants).
Si The King and I est moderne, ce n'est pas par anticolonialisme (que l'institutrice aide le roi à préserver l'indépendance de son pays n'ôte rien à sa visée missionnaire, fût-elle laïque) ni même par féminisme, mais par sa double croyance, dans le progrès et dans sa capacité à s'imposer au reste du monde. À la limite, le progressisme ne serait qu'une forme beaucoup moins agressive d'occidentalisation. Et le progrès, là-dedans, c'est qu'on n'est toujours pas capable d'appréhender une autre culture – même celle de Broadway, me répondront sûrement les enthousiastes du genre. En lisant Paris Broadway, je me dis que l'interprétation de Lambert Wilson n'a peut-être pas aidé : en misant tout sur l'aspect comique de son personnage, il fait du roi un sombre crétin flat character, et ne met pas du tout en avant l'ambivalence d'un monarque tiraillé entre la coutume et l'intuition que son pays a besoin d'ouverture. Sans compter qu'avec le cast semi-couleur locale, j'ai pendant un bout de temps fouillé dans ma mémoire, à la recherche d'un hypothétique épisode de mainmise britannique sur le Siam, qui expliquerait la présence d'un roi blanc et anglophone. Non, encore une fois, c'est l'Occidental qui rêverait que tous ses interlocuteurs le soient. Voir brusquement sa propre altérité en se retrouvant dans l'autre, comme face à soi-même, c'est le privilège des anthropologues. Eux voient le miroir quand nous sommes tentés de nous admirer dans son reflet. Pimpant et entraînant, comme toute comédie musicale qui se respecte.
00:31 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, comédie musicale, châtelet, the king and i
22 juin 2014
Un cygne de la main
Tandis que la rhapsodie pour orchestre d'Emmanuel Chabrier, Espana, sonne bien espagnol, on a du mal à voir en quoi le Concerto pour piano n° 5 de Camille Saint-Saëns serait L'Égyptien. Ce que j'ai pu trouver de plus approchant, c'est un paquebot moderne et luxueux, avec de grandes baies vitrées, qui glisserait à l'aube sur le Nil1. @_gohu, lui, a dû aller jusqu'en Asie pour trouver l'inspiration. C'est dire si le morceau est d'un « exotisme volontairement superficiel » – quoique dépourvu de la langueur capiteuse qui y est souvent associée.
Pour la sensualité, il faut attendre le Concerto pour harpe en mi bémol majeur. Non qu'elle soit particulièrement audible dans la partition de Reinhold Glière : les doigts de Xavier de Maistre m'ont plongé dans une fascination qui m'a fait percevoir chaque son avec acuité et à peu près rien du morceau dans son ensemble. Expérience aussi bizarre que ce beau gosse à la Cocteau (beauté orphique), que l'on verrait bien avec une raquette à la main lorsqu'il revient saluer à petites foulées tranquilles.
La rapidité avec laquelle Yutaka Sado se met à diriger le Lac des cygnes n'en est que plus déroutante. Je peux vous dire qu'il s'est fait essorer, le volatile ! On croirait voir une cassette vidéo accélérée du cygne blanc. Cela m'enthousiasme autant que cela me fait rire, ce qui est loin d'être le cas d'Agnès Letestu, l'air consterné. Mais j'ai visiblement contaminé Palpatine en marquant les têtes des quatre petits cygnes avec mon museau de souris, le chef sautant assez pour compenser les entrechats que je me suis contentée de marquer avec les mains.
1 « Le passage en sol est un chant d'amour nubien que j'ai entendu chanter par les bateliers sur le Nil », confia Saint-Saëns. Hé, j'y étais presque !
23:11 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, concert, pleyel, odp
10 juin 2014
Maps to the supernovas
Lorsqu'Agatha Weiss1, jeune fille qui porte de longs gants noirs curieusement assortis à son look de Star Wars fangirl, débarque à Hollywood, le chauffeur de la limousine2 qu'elle a louée lui suggère d'acheter une carte localisant les stars dans la ville. Pas besoin, elle se repère. C'est donc en la suivant que l'on va relier les personnages tous plus barrés les uns que les autres de Maps to the Stars : il y a notamment Havana, actrice médiocre hantée par le souvenir de sa défunte mère, bien plus célèbre qu'elle ; Stafford, son coach en développement personnel, aux techniques pour le moins originales ; et le fils de ce dernier, Benjie, enfant-star à la grosse tête (au sens propre comme au figuré, avec des épaules tombantes qui accentuent son étrange silhouette), déjà passé par une cure de désintox. On prend un plaisir presque pervers à essayer de distinguer des constellations parmi ces stars – presque pervers parce que plus ça va, pire c'est : hallucinations, pyromanie, inceste, suicide et tentative de meurtre se mettent de la partie, sans que le film se départisse un seul instant de cette distance qu'on dirait comique si elle n'accentuait encore plus la bizarrerie de ce monde asphyxié où l'on se récite la poème d'Éluard comme une comptine macabre. Sur toute chair accordée / Sur le front de mes amis / Sur chaque main qui se tend / J’écris ton nom
La liberté n'est arrivée que lorsque j'ai compris pourquoi le pluriel, pourquoi MapS to the stars. Trois couleurs, qui a décidément des journalistes qui savent conduire une interview, met le doigt dessus : les personnages sont systématiquement « seuls dans le cadre, ils ne sont jamais réunis à l'écran ». C'est que, chacun dans « sa petite bulle individuelle », reprend Cronenberg, il y a autant de cartes que de stars : chacun se pense au milieu d'une constellation, détruisant celles dont il ne se voit pas faire partie, se détruisant lui-même surtout, incapable de trouver sa place. La guerre des étoiles n'aura pas lieu mais le festival de supernovas qui la remplace est un vrai régal.
Mit Palpatine
1 Mia Wasikowska continue d'alimenter ma fascination pour les filles d'origine polonaise (bientôt un #PolishPower pour concurrencer le #CzechPower ?).
2 Robert Pattinson est passé à l'avant de la limousine depuis Cosmopolis. Son personnage conduit tout le monde et ne va nul part, malgré ses rêves d'apprenti scénariste. Trop sain d'esprit, sûrement.
00:06 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0)
08 juin 2014
Gathering at a dance rehearsal
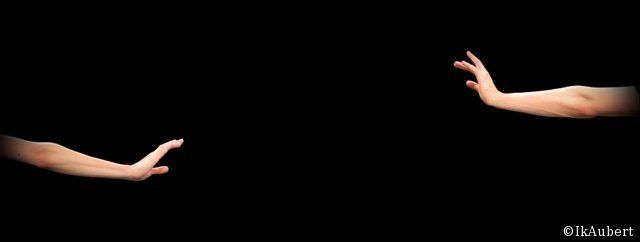
Merci à @IkAubert pour la photo !
Si je devais recommander une manifestation à quelqu'un qui a l'impression de manquer de connaissances pour apprécier la danse, ce serait quelque chose comme la séance de travail de Dances at the Gathering. La répétitrice, Clotilde Vayer, parvient à faire comprendre comment s'apprécie un ballet qui n'est ni pure démonstration technique ni œuvre narrative. Elle ne cède pas à la tentation, particulièrement forte pour les ballets narratifs, d'étendre la stricte équivalence geste-signification de la pantomime au ballet ; elle ne « traduit » pas au fur et à mesure les pas pour raconter une histoire qui leur pré-existerait (c'était par exemple le cas pour la répétition de Mademoiselle Julie). Ses métaphores, jamais filées, font comprendre au danseur que chaque geste doit être porté par une intention, quelle qu'elle soit (pourvu qu'elle soit claire pour lui), et au spectateur qu'il peut interpréter à sa guise les saynètes qui prennent ainsi vie. Ici, un salut à la Ghislaine Thesmar, merci public adoré ; là, une demoiselle qui tourne comme une abeille autour d'un garçon imperméable à ses bavardages ; là encore, un geste esquissé parce que c'est bien assez, on ne va pas démontrer ce qu'il est évident que l'on sait déjà faire...
On constate au fil de la répétition que l'imagination du spectateur se délie à mesure que l'image se fixe pour le danseur : plus le geste est précis, plus il suggère des interprétations diverses. C'est pourquoi, malgré tout le talent des jeunes danseurs que sont Pierre-Arthur Raveau et Héloïse Bourdon, Sabrina Mallem est beaucoup plus passionnante à observer, avec une maturité qui lui permet d'assimiler très rapidement les remarques de Clotilde Vayer. À se demander pourquoi diable je n'ai pas pris de place pour ce spectacle. La réponse est dans la suite du programme : Psyché, sur lequel il faudrait, à l'instar de son héroïne éponyme, fermer les yeux.
Pour un compte-rendu plus détaillé : nos greffières balletomanes, le petit rat et Amélie
10:18 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, séance de travail, répétition, dances at a gathering, robbins, sabrina mallem























