22 novembre 2008
Le Timide au Palais, de Tirso de Molina
Sortie khâgneuse mardi soir à Montansier. Aucun a priori, puisque je ne connaissais pas la pièce, ni même le nom de l’auteur - *inculte power*. Juste la curiosité d’être de l’autre côté de la rampe dans le théâtre où j’ai passé tous mes examens de danse. Montansier pour moi, c’est un vrai terrain de jeu, le jeu de la comédie et le jeu de se croire en spectacle. Un petit Palais Garnier en miniature où l’on allait tester tous les points de vue de la salle – mais surtout celui du parterre- habillées n’importe comment, en chaussons, une chauffe enfilée à la hâte, à observer les autres passer leur variation, dans l’odeur de la laque à cheveux. C’est aussi des loges lumineuses, aussi diurnes que les coulisses sont nocturnes –plus qu’un après-midi au cinéma- qui donnent sur les rires et les rumeurs des jardins du château, curieusement proches par rapport au retour de scène.
Mardi soir, des scolaires qui transforment le hall en cours de récréation, des courses poursuites dans les couloirs, une ouvreuse qui se laisse déborder avec professionnalisme et le poulailler à tous les étages. Je me serais bien passée des commentaires pleins de sébums et d’hormones qui surgissaient derrière moi, mais enfin…
Au début de la pièce, j’ai eu un peu peur : je ne comprenais pas grand-chose à la diction du comte, qui de plus se battait au fleuret, et les premières scènes se sont succédées sans qu’on puisse voir de liens entre elles, ni supposer lesquelles introduisaient l’intrigue principale. Et surtout, une certaine réticence dans la surenchère des effets de comique lourd – avec notamment une battue faite par des paysans bercés un peu trop près du mur, auprès desquels les visiteurs sont fins et subtils – bref, le genre de comique qui entraîne le rire de la salle comme une bande-son de rires préenregistrés – et qu’on vous rajoute une grimace !
Heureusement, j’ai trouvé mon comte, l’intrigue s’est ficelée et le comique a été plus éclaté. C’est une histoire relativement classique, avec un comte veuf qui cherche à marier ses filles, qui n’ont fait qu’à leur jolie tête, des prétendants trop sûrs d’eux et des amants indécis –le personnage éponyme de la pièce, qui vire schizophrène de timidité – ainsi que ce qu’il faut de retournements, de (dé)tours et de pirouettes incroyables à force de vraisemblance. Le parti pris de la mise en scène surtout était excellent. Pas de modernité à tout prix, mais un jeu très contemporain. Le metteur en scène n’a pas hésité à tailler dans le texte (plus de cinq heures en VO – merci pour la coupe !) et à rajouter tout un hors scène très drôle. Un homme vient la bouche en chœur vous expliquer ce qui va suivre, planter le décor en zigzaguant un treillage devant vos yeux de la paume de ses mains, ou annoncer l’acte suivant. Rires à la scène 2 de l’acte 2, quand le personnage assis à sa droite fait deux signes de la victoire à l’annonce de la scène. Et puis aussi lorsque le prologue (si, si, cela lui va bien comme nom) arrive ivre. Et plus encore lorsqu’il se fait le traducteur des didascalies espagnoles et qu’il reste à répéter « la nuit » jusqu’à ce que le technicien envoie un éclairage lunaire. Ce prologue est le pendant extérieur de la mise en abyme interne, l’une des filles jouant à l’actrice. Amusant clin d’œil qui déclenche de l’hilarité lorsqu’en professeur tout à fait conforme à la Bacchante, le prologue retourne le miroir et se met à nous exposer le schéma actantiel de l’acte manquant pour la vraisemblance d’un retournement tout à fait improbable – et oui, oui, le timide paysan est bien le fils d’un noble seigneur (pas Romulus, mais tout juste). Les personnages inconnus se déclinent en initiales sur le tableau, entourées, liées entre elles, croisées avec une lettre qui ne nous évoque plus le reste du nom ; l’adjuvant se retrouve au coin sous forme d’un smiley et l’hilarité fait salle comblée lorsque, mimant le si commode secret de famille du père prodigue, le prologue finit par agoniser et ses derniers tressaillements tracent à la craie un diagramme cardiaque agité. Il défaille en ligne droite et je suis morte de rire. Un acte en un éclat de rire, c’est ce qu’on appelle de l’efficacité.

C’est un univers de jeu ; le prologue (le vrai, pas le personnage) montrant un atelier de couture comme décor. Les robes invitent au costume, les étoffes au déguisements, tandis que derrière un rouleau de tisse au mètre, un piano accompagne ces histoires enfantines. Une chute de tissu sert d’interlocutrice pour renvoyer une fiancée, et même les accessoires sont parfaits pour embobiner Séraphina, la fille aînée du comte. Le prétendant lui mime son bobard avec des personnages en bobines de fil, le duc en bleu, l’enfant illégitime en canette du même acabit et les espions en noir qui volettent autour comme des corbeaux aux mains du prétendant. Cousu de fil blanc ! Et lors du prologue les mimes des machines à coudre… vraiment, le « jeu corporel » des acteurs en fait de véritables mimes. Mention particulière au héraut qui, alors qu’il raconte quelque histoire vraisemblable qu’il a attrapée à la volée, semble jouer au tennis, court de la cour au jardin, renvoie une réplique, attrape une réponse avant qu’un autre personnage saisisse toute l’affaire en attrapant la balle. Vraiment, toutes ces manières de traiter les digressions du récit sont réjouissantes, et quel rythme !
Il y a aussi, au fil de la mémoire, un lit dressé à la verticale et sur lequel le timide recroquevillé par terre semble assis, puis sous lequel il se cache au gré du rêve agité de son amante ; le héraut étranglé parce que sa voisine tire sur son cartable pour ne pas voir le duel qui a lieu ; un comte recroquevillé qui se croit le « roi des écrevisses » (applaudissements pour cette absurdité)… J’ai vraiment passé un bon moment, à rire sans arrière pensée.
Par la Compagnie du Catogan / Mise en scène Gwenhaël de Gouvello / Adaptation Robert Angebaud / Avec Gregori Baquet, Jean-Michel Canonne, Brigitte Damiens, Marie Grach, François Kergourlay, Marie Provence, Rainer Sievert, Stephen Szekely, Jean-Benoît Terral, Éric Wolfer.
Création musicale Damien Joëts, Christian Huet / Décors Éric den Hartog / Costumes Anaïs Sauterey / Lumières Stéphane Baquet / Maquillage Laurence Otteny
Voilà qui résume : Sur un ton un peu goguenard, dans un décor de carton-pâte, avec des costumes qui ne se prennent pas plus au sérieux que les comédiens qui les portent, tous conduisent avec une belle énergie et dans un véritable esprit de troupe cette comédie légère de cape et d’épée qui ne parle que d’amour.
23:30 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théâtre
24 octobre 2008
Prise de la Bastille par le New York City Ballet
J’ai avalé gloutonnement quatre soirées de ballets et n’ai pas même pondu un bref post. Cela vous a peut-être évité une indigestion suite à une omelette géante, mais tout de même, le New York City Ballet ne vient pas tous les quatre matins. Un mois déjà – les chorégraphies s’estompent pour laisser en souvenir des impressions et des flashs éblouis- mais je vous invite à faire le pique-assiette et à goûter à tous les plats.
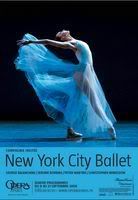
Avant le spectacle…
… entendre ses talons claquer, apercevoir les gens en train de grignoter un sandwich, qui semblent habiter là, et entendre la sonnerie à l’entracte…
… l’odeur du programme, dont l’encre ou le papier, je ne sais pas, ne semble être utilisé que par l’opéra de Paris. Une splendide photo de Sérénade dessus – heureusement, ils ont cessé leurs essais de trucs conceptuels à tentative pluridisciplinaire.
… le réglage des jumelles, pour espionner en toute bonne conscience les musiciens déjà dans la fosse, les violonistes qui discutent ensemble avec enjouement, un jeune homme situé dans la région des instruments à vent et qui semblait s’ennuyer ferme, un moins jeune dont maman n’a pas réussi à voir s’il avait une alliance à la main…
… former une haie de déshonneur pour ceux qui arrivent un peu tard…
… saluer avant qu’il ait rien fait le chef d’orchestre, comme pour se dédouaner de n’y plus penser par la suite…
En pleine apnée…
Divertimento n°15
Chorégraphie de Balanchine sur du Mozart
Des costumes un brin vieillot avec des couleurs un brin violentes (même si je n’ai rien contre le turquoise fluo dans l’absolu), mais la chorégraphie est tout sauf poussiéreuse. Les photos peuvent être trompeuses parce qu’elles prennent toujours les instants structurés, les lignes harmonieuses et les symétries impeccables alors que tout l’intérêt est justement dans la déstructuration, le jeu sur les formations et reformations, les décalages, les groupes, duo, solo, trio où les partenaires se dédoublent pour qu’aucun duo ne soit en reste… Virtuose peut-être, mais avec goût.
[Et puis je ne sais où, un sourire comme je n’en avais jamais vu. Charme sûr de lui mais surpris d’être découvert.]
Episodes
Chorégraphie de Balanchine sur une symphonie de Webern
La musique est déconcertante, presque discordante de prime abord, mais la chorégraphie a tôt fait de nous la faire écouter – et plus seulement entendre. Justaucorps noirs et collants blancs, le plaisir des lignes cassées, une géométrie pour les yeux.
Tchaïkovsky Suite n°3
Chorégraphie de Balanchine sur… du Tchaïkovsky, vous vous en seriez douté.
Une première partie en robes roses et violettes cheveux détachés, une seconde en tutus plateaux. Entre deux le soulagement de ne pas en rester à un élan kitsch.
Sérénade
Chorégraphie de Balanchine sur Tchaïkovsky
Le rideau se lève sur une forêt de danseuse en sixième, face au public, la tête côté jardin qui regarde vers une main paume tendue dans la même direction, poignet cassé.

C’était le ballet que j’avais envie de voir. Celui dont on voit des photos partout, avec ces grandes jupes fluides et une vague auréole romantique. Même là, Balanchine ne réussit pas à faire du mièvre : il y a toujours une énergie folle – des réminiscences de danses guerrières géorgienne, m’apprend le programme.
Les danseuses semblent petites – du coup jamais de bras arachnéens mais un concentré d’énergie, bras et jambes qui tranchent l’air avec violence, sans pourtant altérer l’ambiance de douceur qui s’est installée sur le plateau.
Symphony in Three Movements
Balanchine sur une musique de Stravinsky
Une terrible joie et de la force. Ca éclate, déboule en tous sens, saute avec enthousiasme - les pieds en blancs des garçons en collants noirs sont autant de notes en négatifs qui viennent suspendre en l’air une partition exultante. Des duos en rose et noir. Et toujours d’immenses queues de cheval qui donnent un air d’amazones gymnastes à cette immense diagonale de filles, qui se dressent par le même mécanisme. Une grandeur imposante, renforcée par la perspective des tailles – lorsque la colonne se déroule, on découvre que les amazones du fonds font une tête de moins que celles du premier plan.
Brahms/Handel
Chorégraphie de Twyla Tharp et Jerome Robbins
Verts et bleus, les corps coulent, fluides. Des courants calmes mais à la vigueur sûre, aux nombreux revirements sans aucun débordement. Des portés ahurissants qui ne semblent même pas académique… assez insaisissable. Une des principals, Sara Means, d’une grande classe.
Première chorégraphie qui n’est pas de Balanchine et moyen d’observer ce qui relève de la chorégraphie et ce qui relève des danseurs… du moins, je le croyais. Parce que ces derniers son tellement imprégnés de Balanchine, qu’il est pratiquement impossible de faire la distinction. Autant chercher comment la Berma magnifie ses vers.
Duo Concertant
Chorégraphie de Balanchine sur une musique de Stravinsky
Le piano est sur scène, le violoniste aussi. N’oublions pas le couple de danseurs, embusqué derrière le piano. Qui écoute rêveur et reviendra souvent tâcher de rêver – mais plus sûrement de reprendre son souffle. Avec cette mise en scène- à proprement parler-, le spectateur est obligé de sentir la musique et son lien avec ces pas joueurs et flex qui viennent en cascade.
Surtout dans une scène noyée dans l’obscurité, l’image d’un cercle de lumière où vient se créer une main, un mouvement, apparaître un visage et disparaître le corps en son entier. D’accord, Malliphant n’a pas tout inventé (mais sur ce coup-là, je préfère Malliphant).
Hallelujah Junction
Chorégraphie de Peter Martins sur une musique de John Adams
Avant toute chose, il y a, suspendus au fond de la scène, dans un arrière-plan onirique –mais noir- deux pianos face à face, deux pianistes éclairés par deux lumières qui sculptent le reste d’obscurité en deux diagonales croisées. Un voile noir a beau être interposé entre les pianistes et les danseurs, il se dégage tout de même une force folle de ce curieux orgue moderne.
La chorégraphie, en notes blanches et noires, mêle les décalages, contrepoints et canons. Tout est toujours en tension, même les huit tours de Daniel Ulbricht, même les dessins géométriques qui sont étirés comme s’il s’agissait d’élastiques tendus au maximum.
After the rain
Chorégraphie de Christopher Wheeldon sur Arvo Pärt
Comment donner le degré de mon engouement sans verser dans l’enthousiasme délirant ? Passé les trente premières seconde où il m’a fallu me défaire de la chorégraphie que j’avais dansé sur cette musique-là – de Dos Santos (ou quelque chose comme cela)- et m’accoutumer à la grande maigreur de Wendy Whelan (qui fait corps avec Sébastien Marcovici), c’est magnifique merveilleux magique poignant ? On oublie totalement qu’il s’agit de danse, qu’il y a une chorégraphie que les deux interprètes ont du apprendre et travailler, et on laisse se laisser hypnotiser par ce temps de vie. Corps noueux et cheveux détachés comme un feuillage – liane- attachement – duo racinien.
[Faites taire les deux imbéciles derrière qui assassinent déjà la chorégraphie la résonnance de la dernière note à peine évanouie.]
Dances at a Gathering
Chorégraphie de Jerome Robbins sur des Mazurkas, Valses, Etudes, Scherzo et Nocturne de Chopin
Au siècle dernier, celui, intemporel, de la nostalgie et du souvenir, une rêverie sur des rencontres amicales, espiègles, amoureuses, fraternelles, passionnées, attendues, retardées, déclinées, qui n’ont peut-être jamais eu lieu ou alors d’antan, déjouées mais rejouées sur scène… Apaisant mais pas lénifiant ; subtile, plein de vie et de finesse, cela glisse, fluide comme les robes des jeunes filles, jusqu’à la fin où les danseurs se tiennent immobile face aux spectateurs mais regardant bien plus loin, comme à travers eux.
[Dit comme ça, ça a l’air kitschissime, mais je vous assure que ce n’est pas le cas, que l’on s’amuse à retrouver tel danseur avec telle ou telle partenaire (je crois que c’était pour la danse d’Ashley Bouder que j’ai eu un faible, et pour Amar Ramasar), à voir les couples se reformer, et à surprendre des clins d’œil d’humour]
Carousel (A dance)
Chorégraphie de Christopher Wheeldon sur « The Carousel Waltz » et "If I love you », Richard Rodgers
Ambiance foraine, guirlandes aux tringles et triangles rouge dans les fentes des jupes violettes. Benjamin Millepied (après Petipa, avouez que c’est un nom qui claque pour un danseur !), formidable forain. Et surtout ce manège qui n’a jamais si bien porté son nom, où les cavalières sont devenues chevaux de bois, et, une barre dorée à la verticale, galopent sagement par monts et par vaults.
Tarentella
Chorégraphie de Balanchine sur une musique de Louis Moreau Gottschalk
Pittoresque si l’on s’arrête aux costumes. Virtuose sans aucun doute. Feu d’artifice (et) d’artifices techniques. On ne compte plus les tours ni ne peut nommer les entrepas qui s’enfilent en un rien de temps – en moins de temps que cela encore- semblent devancer la musique. Megan Fairchild et Joaquin De Luz sont époustouflants et brillants. Pas un étalage technique comme raillent d’autres charmants voisins de derrière, mais une grande éclaboussure d’énergie riante.
Barber Violon Concerto
Chorégraphie de Peter Martins
Deux couples qui se répondent : un classique pur, pointes, chignon banane, brillant à l’oreille pour elle, chemise bouffante pour lui, grande classe ; un plus contemporain, robe toute simple et queue de cheval pour elle, collants pour lui. Le classique qui par d’amples mouvements, nous donne un beau pas de deux (image du couple de dos, croisés en grande fente) ; le contemporain plus ancré dans le sol. Puis classique et contemporain dans une drôle de juxtaposition où les couples dansent côte à côte sans se voir, se croisent en des trajectoires qui s’évitent… on voit où la chorégraphe veut en venir mais la mayonnaise met du temps à prendre (et ce n’est pourtant pas faute d’ingrédients alléchants). Enfin, les deux pas de deux de la dernière partie ou les couples se sont dissociés : tout d’abord celui passionné du contemporain (Albert Evans) et de la classique (Sara Means – cette fille est la classe incarnée) à qui l’on semble d’abord faire violence, dont la retenue résiste, et qui finit, les cheveux dénoués, par s’abandonner totalement à son nouvel amant. Quant au classique (Charles Askegard), que l’on pouvait penser être resté seul aux prises du désespoir d’avoir perdu son élégante moitié, il est surtout aux prises de la contemporaine (Ashley Bouder), véritable petit morpion qui a résolu de ne pas lui ficher la paix. Un drôle de combat s’engage alors, où tous les coups sont permis – et hop, que je te file entre les jambes- y compris les attaques par derrière – le petit morpion collé au dos de sa proie et la déséquilibrant, c’est un nouvel Janus que l’on voit traverser la scène. Inégal mais finalement réjouissant.
West Side Story
Chorégraphie de Jerome Robbins, musique de Bernstein
La comédie musicale condensée à ses passages dansés. Mention particulière à Gretchen Smith (si je ne me trompe pas) véritablement endiablée. Et dans les scènes de rue entre les deux gangs (les sauts, gosh !) c’est du pur délire… comme dans le public en fait.
No doubt, « I like to be in Amer-i-ca ! »
16:26 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : danse, ballet, chorégraphie, bastille, new york city ballet, wheeldon, balanchine
28 mai 2008
Coupé –assemblé
Ce post m’avait donné envie de lire Mythologies, et un lundi matin de grande lassitude envers mon Gaffiot (ne faisant pas de latin du week-end, je m’y mets la veille pour le lendemain) j’avais subrepticement pris l’ouvrage de Barthes sur les rayons du CDI. Le temps d’emprunt du CDI étant ce qu’il est, j’avais grappillé quelques mythes modernes qui me parlaient et condamné le reste au silence. En allant à Gibert il y a quelques jours, je suis retombée dessus (en occasion en plus, si ce n’était pas un signe, ça). J’ai commencé à lire dans l’ordre, donc sans sauter le « Catch », premier article qui ne m’avait guère inspirée. Et bien que l’on en soit à cent lieues, j’ai pensé à la danse qui elle aussi est à la frontière entre sport et spectacle, quoiqu’elle soit sport qui tend au spectacle tandis que le catch est, comme le montre Barthes, un spectacle qui se prétend sport. Je ne sais pas vraiment pourquoi le glissement m’est venu à l’esprit ; peut-être cette comparaison malheureuse, « trop musclé comme un mollet de danseuse », qui relève elle aussi d’un certain cliché. J’ai souvent l’impression que pour la plupart des gens, la danse, c’est ça, une succession de clichés. Alors pour remettre un peu de mouvement dans tout ça, voici un petit démontage de la boîte à musique, ritournelle d’un côté et danseuse en plastique de l’autre.
Coupé : pile, image mielleuse, face, image amère, et une pièce qui ne se rejoint jamais
Amer
La danse, c’est la souffrance ; les pointes, des instruments de torture ; les auditions, un panier de crabes ; le ballet, un monde de requins. A décliner avec toutes les variantes possibles : acharnement, labeur, douleur, école de rigueur, orteils sanglants, pestes, régimes, orgueil, piston… on ne manque généralement pas de synonymes. Certes, pour devenir professionnel, il est recommandé d’avoir une santé de fer et un moral d’acier ; à la fois la dureté et l’éclat du diamant. Bien sûr, il y a des pestes (c’est malheureusement un fléau universel). Assurément, on maudit les pointes à chaque fois qu’on en inaugure une nouvelle paire (et je maudis particulièrement les revendeurs français pour ne pas importer de pointes russes). Sûr qu’on ressort d’un cours autrement plus fatigué que d’une promenade de santé. Certes. Mais. Pas seulement. Et ce n’est pas non plus l’autre cliché extrême, plus écœurant encore – parce que si la vision de martyr a au moins le mérite de reconnaître le travail du danseur, celle de l’étoile l’enrobe de paillettes un brin aveuglantes.
Mielleux
La ballerine noyée dans une barbe à papa de tulle et de lumières – tutu plateau, pointes, et cherry on top, le diadème. Vous pouvez tout de suite refermer la boîte à musique, la magie de la scène n’est pas là. Il n’y a rien de pire que cette mièvrerie, toute contenue dans le mot de « ballerine » que n’emploiera jamais une danseuse. A la rigueur, elle piétine le mot dans un modèle Repetto hors de prix, la marque si connue étant devenue l’emblème de la danse… à la ville. En studio on lui en préférera d’autres, sauf peut-être pour les pros qui recourront à du sur mesure.
La mièvrerie rose dragée ne connaît que trois pas :
- l’arabesque, LA pose photogénique par excellence – un beau cliché donc
- la pirouette (cacahuète)
- l’entrechat, pour faire pendant à l’appellation d’origine contrôlée de « petit rat » - « de l’Opéra » pour la rime.
La mièvrerie rose dragée pense…
… qu’on ne danse que les bras en couronne (visualiser ici une imitation simiesque) et sur du Tchaïkovski
… que la danse ne demande aucun effort.
… qu’on prend les cours en tutu. On en trouve une réminiscence dans Billy Elliot où les gamines des mineurs sans le sous sont en tutu (costume de scène, faut-il le rappeler, assez cher pour ne pas dire parfois hors de prix), alors que de simples justaucorps seraient en réalité un uniforme assez inespéré.
La mièvrerie rose dragée est un attendrissement maternel, résultant parfois d’une frustration personnelle.
La mièvrerie rose dragée m’écoeure. C’est en partie à elle que l’on doit la démographie bancale des cours de danse où les garçons se font rare et où les classes se clairsement avec l’âge (même si le cours surpeuplé au-delà d’une certaine densité expose mes voisines au risque de se prendre un coup de pointe pendant les grands battements).

Réalisé à partir de phots trouvées sur... des skyblogs. Non, non, je ne tire aucune conclusion.
Il y a pire que la mièvrerie rose dragée, qui au moins se repère de loin. Il y a la mièvrerie blanche, tout aussi dégoulinante de bons sentiments. Blanc comme la feuille blanche d’où l’on part ; 0 capacité, 0 soutien familial, 0 pointé. Blanc comme le succès éclatant auquel on arrive, par une chance non moins éclatante qu’on rebaptise travail. Cette dernière substitution permet de réintégrer l’autre cliché, celui de la dureté, dont on cache l’amertume en la faisant toujours suivre du doux goût sucré des efforts récompensés.
Le mythe de la self-made dancer constitue ainsi la trame de la plupart des films de danse. Dans Save the Last Dance, elle finit par intégrer la Julliard School, épaulée par un nouvel amour (parce que si la danseuse n’est plus à présent confondue avec la courtisane, elle demeure aimable, et il est de bon ton de marier la mièvrerie rose dragée avec une fleur bleue). Dans Center Stage (Danse ta vie sous nos latitudes, les Français ayant tout de même le chic pour nous pondre des titres d’une niaiserie achevée – et ils aiment beaucoup la vie, parce que cette année je regardai un film, une histoire de musicien, rebaptisée Les gammes de la vie quand le titre de la VO était Die Zeit, die man Leben nennt - approximativement, et que l’on peut à peu près traduire par « L’instant qu’on appelle la vie »), bref, dans Center Stage, donc, la self-made dancer rentre à l’ABT school, alors même que sa technique n’est pas d’une propreté irréprochable – remarquée pour un certain on-ne-sait-quoi (en fait par la caméra qui fait un gros zoom sur la candidate à la self-made dancer – et ça, je peux vous dire que c’est du cinéma. Du moins en France, où les écoles prennent parfois des filles au charisme de navet bouilli pourvu qu’elles battent leurs chats six – même si d’autres ont toute la classe requise, n’est-ce pas Virginie ?). Bref revenons à nos moutons exgregius. Ils bataillent dur, accumulent les échecs, travaillent dur, et finissent par réussir, toujours de façon fulgurante et éclatante – il est bien connu que l’on passe de vilain petit canard à cygne noir par un coup de baguette magique.
J’aimerais bien parfois voir des films qui ne finissent pas en apothéose. Des filles qui se plantent sans pour autant s’effondrer. Quoique ce soit peut-être le bon sentiment de trop : réussir non pas à surmonter mais à accepter son échec, pensez. Surtout que la leçon d’humilité risquerait de se transformer en hymne au martyr. Pour la danse classique. Curieusement, il n’en va pas de même dans les films de danses de salon. Cela fait un bien certain de voir le plaisir de danser mis à l’honneur, même si l’on échappe pas toujours aux clichés. Dance with me m’avait à ce titre assez plu, malgré son côté je-sors-les-jeunes-de-leur-misère et ses inévitables couples (quoique démultipliés, ils soient paradoxalement plus supportables) (Dance with me dont le titre original était… Take the lead. Dans la catégorie je garde l’anglais parce que ça fait moins tarte, mais je donne un titre basique pour que tout le monde comprenne, c’est pas mal je trouve). Shall we dance ? (on remarquera une grande originalité dans les titres) ne tire pas mal son épingle du jeu, et par une pirouette (planée) évite de se figer dans le cliché. Ainsi, même si le protagoniste se trouve embarqué dans des cours de danse de salon pour le visage d’une belle jeune fille (déjà, un léger décentrement, ce ne sont pas les yeux), il n’en tombe pas amoureux, la sensualité (un chouilla exagérée) demeure l’apanage du tango, et les cabris (caracolant sur le quai de la gare) sont bien gardés. Il danse parce que ça lui fait du bien – et à nous aussi.
Il n’est cependant pas tout à fait anodin que ces films mettent à l’honneur les danses de salon, qui, ainsi que semble l’indiquer leur nom, devraient rester confinées dans un espace privé. Un autre problème se dessine en réalité : non plus montrer que la danse (classique) est un art sérieux pour lequel il faut se battre (plus que travailler, un peu de violence en guise de passion), mais que la danse (de salon) existe pour de bon. Dans Dance with me, le professeur de danse, qui se jette dans la gueule du loup en allant donner des cours de danse à des cas désespérants plus que désespérés de jeunes en échec scolaire, a tout le mal du monde à leur faire admettre que ce n’est pas un « truc de ringards ». S’il y réussit en employant la manière forte avec ses jeunes protégés, rien qu’à en juger par les sièges vides de la salle de cinéma, il y a encore du pain sur la planche pour convaincre de l’actualité de ces danses qui sont autre chose que la survivance des bals de nos arrière-grands-parents.
Assemblé : rendre la monnaie de sa pièce
Comment faire coexister les deux clichés dont on sent bien que la vérité se trouve quelque part entre les deux (souvenance émue du cours sur Pascal) ? Les films livrés avec faire-part et dragées ont choisi de les faire se succéder, puisque les faire coexister sans modulation revient à faire l’éloge du masochisme (ça fait mal mais c’est bon – parce que c’est beau). Pourtant, il y a de ça. La différence essentielle vient du fait que toutes ces perceptions viennent de l’extérieur tout en se voulant intérieures : le spectacle est beau donc je nie tout travail, ou je vois des exercices qui me paraissent relever de la torture donc c’en est.
On ne parvient pas à concilier les deux clichés pour la simple raison qu’ils ne s’appliquent au même objet : le miel renvoie à l’art tandis que l’amer renvoie au sport. Clichés inconciliables parce qu’ils renvoient à la contradiction même de la danse qui, pour le danseur, est un art qui passe par le sport – mais ne le devrait pas pour le spectateur. Pour celui qui la pratique, la danse est artistique dans le sens où elle concourt à former ce qui est ensuite (si on est en studio) ou simultanément (en scène) perçu comme art. L’œuvre d’art n’existe que lorsqu’elle est détachée de sa genèse et de l’artiste. Or dans la danse l’artiste est en même temps le matériau. Le seul moyen d’éviter les glissements qu’il y a là en puissance est de préserver la distance qu’instaure la scène – que le ballet reste bien inaccessible de l’autre côté de la rampe. C’est pour cela qu’en visite guidée, la scène perd toute magie, révélant ses mécaniques, scotchs au sol, cintres nus et câbles en tous genre, qui tranchent avec le velours des sièges et les dorures du plafond (je pense au Palais Garnier). Elle a perdu toute vie, ce pour quoi elle a été instituée n’a pas lieu. Pas de cérémonie. Tandis que lorsque cette dernière a lieu, la scène devient un temple avec ses décors, ses costumes et ses lumières et… ses dieux, rangés dans le ciel sous l’étiquette d’étoile (encadrés par des dizaines d’astéroïdes au statut de demi-dieux). Est-ce un pur hasard si Claire-Marie Osta, étoile à l’Opéra de Paris, a hésité à entrer dans les ordres avant d’embrasser la carrière de danseuse ? ou si dans le livre Itinéraire d’étoiles, la légende de l’une des (superbes) photos indique : « la barre, cette prière du danseur » ? - il s’agit bien là d’une mystification nécessaire, celle qui fait passer du plan de la mécanique du corps humain et celui de l’œuvre d’art. A la différence de…
L’image mielleuse : les danseurs vous tiennent la dragée haute, et s’amusent de ce que vous adorez les idoles plus que les dieux, ce qui contribue à leur donner ce rang plutôt que la puissance qui s’en dégage. Mais il se trouvera relativement peu de groupies dans le monde de la danse : les véritables fidèles, passé l’âge de bout d’chou, ont vite fait de troquer leur panoplie Barbie délavée et leur chigon-champignon contre une tunique noire (non couleur comme négation). [Je ne prêche pas pour autant la suppression du rose… il s’en trouvera certaines qui, venues à la danse pour le tutu, n’y verront bientôt qu’un symbole].
L’image amère est au final peut-être la plus révélatrice, parce que doublement trompeuse. Elle n’est pas, en effet, le négatif du cliché rose mais plutôt son double. J’ai compris cela en lisant le deuxième article de Mythologies, « l’acteur d’Harcourt » : « […] Passé de la « scène » à la « ville », l’acteur d’Harcourt n’abandonne nullement le « rêve » pour la réalité ». C’est tout le contraire : sur scène, bien charpenté, osseux, charnel, de peau épaisse sous le fard; à la ville, plane, lisse, le visage poncé par le vertu[…]. A la scène, trahi par la matérialité d’une voix trop musclée comme les mollets d’une danseuse ; à la ville, idéalement silencieux, c’est-à-dire mystérieux, plein du secret profond que l’on suppose à toute beauté qui ne parle pas.[…] / L’acteur, débarrassé de l’enveloppe trop incarnée du métier rejoint son essence rituelle de héros, d’archétype humain situé à la limite des normes physiques des autres hommes. […] la foule des entractes qui s’ennuie et se montre, déclare que ces faces irréelles sont celles-là mêmes de la ville et se donne ainsi la bonne conscience rationaliste de supposer un homme derrière l’acteur : mais au moment de dépouiller le mime, le studio d’Harcourt, à point survenu, fait surgir un dieu, et tout, dans ce public bourgeois, à la fois blasé et vivant de mensonge, tout est satisfait. »
Dans la danse aussi, un mythe se substitue à un autre : la danseuse « gracieuse » (voilà un autre mot que je déteste, typique d’un regard vaguement niais et pourtant assez juste.. gracieuse… grâce… ) laisse place au self-tortionnaire. Il ne s’agit pas de faire que l’étoile s’écrase au sol comme une vulgaire météorite mais paradoxalement de renforcer son caractère fantastique. Rappeler que la Willis a un corps, c’est souligner l’habileté avec laquelle elle maîtrise ce corps. De ce qu’elle en fait presque ce qu’elle veut, la danseuse demeure essentiellement Willis ; le corps trop humain est modelé par une volonté qui ne l’est presque plus. On admire à l’égal du résultat le travail qu’il a fallu fournir pour y parvenir. En somme, on a métamorphosé le dieu en « surhomme », peut-être parce que, même s’il est tout aussi inaccessible, il paraît plus proche, il n’est plus sans commune mesure.
Ce second cliché est donc plus complexe que le premier, d’autant plus qu’il est à l’occasion lui-même utilisé par les chorégraphes : on peut citer par exemple Véronique Doisneau de Jérôme Bel, à l’affiche de l’Opéra de Paris il doit y avoir quelque chose comme trois ans. Je ne l’ai pas vu (ni malheureusement Etude qui était dans la même soirée), mais les critiques montraient assez qu’il s’agissait bien d’une mise en scène de l’hors scène – le mythe de la démystification. Ce type de métalangage est toujours intéressant… pourvu qu’il ne se substitue pas entièrement pas entièrement au langage d’origine (et apparemment, c’était plus ou moins une des critiques adressées à cette pièce).
Si cette vision de la danse se généralise, il risque d’y avoir un certain dérapage de l’art vers le sport… un amour de la prouesse d’autant plus dangereux pour l’art qu’il transforme ce dernier en sport sans en donner les règles et donc sans lui donner les moyens de devenir populaire. Combien de fois j’ai entendu dire « Je ne comprends rien à la danse ». Comme s’il y avait quelque chose à comprendre. Les codes sont là pour les danseurs bien plus que pour les spectateurs. Cherche-t-on à « comprendre » la musique ? – pas au sens strict du mot il me semble. La musique comme la danse nous « parlent » au sens où elles nous touchent. Il ne serait même pas illogique que la danse nous touche plus facilement que la musique, puisqu’elle en est, non pas une illustration (attention, là je mords), mais une transcription qui se donne en simultané. Le danseur devant être dans l’intensité pour pouvoir transmettre l’émotion, le travail est mâché, presque par procuration (d’où l’on voit que le cliché tout rose de l’absence d’effort n’est pas loin) – du prêt-à-ressentir. La virtuosité est fascinante, mais elle l’est bien plus encore lorsqu’elle parvient à se faire oublier… comme Aurélie Dupont dans la Dame au Camélias… mais là on rentre dans le domaine du spectateur émer(ê)veillé !
15:40 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (10)
31 décembre 2007
Casse-Noisette, pas d'étoiles mais des flocons
Nous avions décidé avec deux amies d’aller voir Casse-Noisette à l’Opéra. Il était moins une, c’était la dernière. Dans ma grande naïveté, je pensais que j’aurais des places de dernière minute (à visibilité réduite, vous savez, le truc où vous ressortez avec un torticolis, mais aucune importance, vous avez pu voir – à peu près) aussi facilement qu’à Garnier j’en avais eu pour la Dame aux Camélias. Mais les places debout à 5 € de Bastille ne sont pas à visibilité réduite. En soi, c’est plutôt une bonne chose. Seulement, cela se sait (pourquoi ne suis-je jamais au courant de rien ?). Donc lorsqu’on se pointe comme des fleurs une demi-heure avant l’ouverture des guichets, il y a déjà largement de quoi pourvoir les fameuses 62 places. Il faut dire que l’on cumulait : samedi soir de vacances et dernière (j’excepte la soirée du réveillon où les places sont exorbitantes et j’imagine complètes cinq minutes après l’ouverture des réservations) d’un des ballets les plus connus, les plus populaires et qui plaisent le plus aux enfants comme aux non-connaisseurs (rien que les costumes valent le déplacement), dernière également d’un ballet dont nombre de représentations ont été annulées à cause de grèves du personnel (oui, personnel est au singulier, même s’il y avait des techniciens au pluriel). Là, j’allais maudire ma naïveté, lorsque Melendili a aperçu dans la file d’attente une khâgneuse de notre classe. Qui, après l’échange de quelques courtoisies hurlées pour cause de séparation par escalier, a accepté de nous prendre des billets, chaque personne ayant le droit à deux places. La troisième copine qui devait nous rejoindre a accepté de rester sur Versailles, et ceci constitue le deuxième volet de nos aventures extraordinaire.
[Ce n’est que partie remise, s’était-on dit. Nous irons demain voir Paquita au Palais Garnier. Mais avec notre sens aigu de l’organisation, nous avons réalisé quelque demi-heure avant le début de la représentation de matinée qu’il n’y avait pas de représentation ce soir-là. Et bien évidemment, c’était la dernière. D’où que nous nous sommes simplement vues à la maison. Mais mon sens de l’organisation désormais légendaire a cependant réussi à dénicher la cassette du ballet en question, dont je ne soupçonnais même pas l’existence.]
Je reviens à Casse-Noisette. Figurez-vous que les places debout, dans des boxes au fond du parterre sont sans commune mesure avec les places à visibilité réduite de Garnier. Chose extraordinaire, vous voyez vraiment. Evidemment, être grande ne gâche rien, et les talons, s’ils aident à vous flinguer les reins, sont plutôt bienvenus pour voir par-dessus la tête du Russe qui fait le pied de grue devant vous. Toujours est-il que lorsque Noël commence sur scène, on est happé par le spectacle et que lorsque les lumières se rallument pour l’entracte, 50 minutes après le lever du rideau, Melendili me souffle « Déjà ? ». Je n’ai pas vu le temps passer non plus.

Finalement, être assez loin de la scène a aussi son charme. On cesse de se focaliser sur telle variation, de se pâmer devant la propreté du bas de jambe, de soupirer devant la hauteur des levers de jambe pour saisir la géniale chorégraphie du corps de ballet et les variations dans leur ensemble. Je ne sais pas si c’est le recul spatial ou temporel qui permet cela, toujours est-il que le ballet m’est apparu dans une plus grande lisibilité. L’habitude de la pantomime, de la musique et de la structure d’un ballet y aident sûrement. Quand vous êtes un môme de huit ans qui va à l’Opéra pour la première fois, l’ordre réglé du pas de deux, par exemple, vous échappe. Vous vous laissez emporter au gré des valses et des manèges – la tête vous tourne lors des fouettés. Puis, au fur et à mesure des représentations auxquelles vous assistez (et des cassettes que vous vous passez en boucle), le ballet cesse de faire un tout homogène : vous y distinguez les ensembles, les pas de trois, les variations, et à l’intérieur, les pas, les reprises et finalement les thèmes qui caractérisent les personnages principaux. Arrive ensuite un moment critique où on se laisse hypnotiser par les chats 6 impeccablement battus, les développés seconde aux oreilles et les équilibres interminables. C’est la période de la danseuse amateur qui n’est pas assez connaisseur pour être amateur au sens noble du terme. Vous appréciez certes le spectacle, mais comme un juge, qui pour ébahi qu’il soit n’en oubliera pas moins ses maniaqueries du juge. Le ballet flirte avec la performance de cirque. Puis quand vous vous êtes quelque peu habitué à la surenchère de batterie, de levers de jambe et de coup de pieds démesurés, abreuvé d’exploits techniques sur U-Tube, vous pouvez alors devenir l’amateur qui aime simplement ce qu’il voit. Vous ne vous demandez plus ce que signifie tel geste de pantomime comme le novice, vous ne décortiquez plus (du moins plus systématiquement) la chorégraphie, mais au contraire, celle-ci fait sens. Des langoureux déhanchés de la danse arabe aux équilibres décalés de Clara tiraillée par ses visions cauchemardesques, tout est clair – brillant même.
Et toujours en ressortant l’envie de danser, de travailler la variation de Clara après la valse des fleurs, celle avec les emboîtés retenus, presque retardés, comme si on avait remonté une horloge et qu’elle arrivait au bout de sa course, une fin de rêve qui s’étiole en douceur. Une étoile filante ; un vœu : après glisser comme une ombre dans le troisième acte de la Bayadère, je voudrais devenir un flocon. Des envies d’éphémère.
12:19 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0)



























