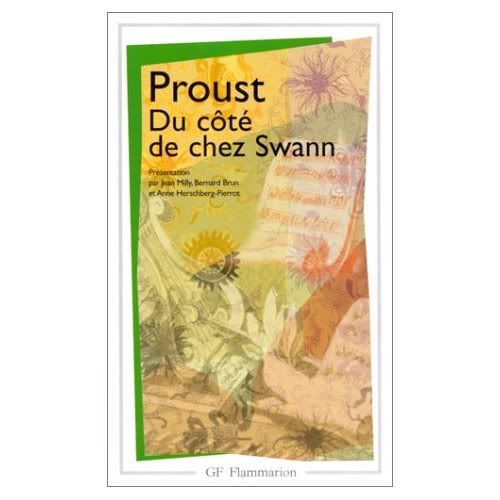19 novembre 2006
C’est un nouveau roman, ce n’est pas une belle histoire
… c’est une écriture d’aujourd’hui. Génération zapping avant l’heure. Imaginez que vous êtes assis dans votre canapé avec deux amis ayant chacun une télécommande et des goûts très différents. Ils n’arrêtent pas de se battre, de changer continuellement de chaîne. Un grand plan de bataille de péplum dérive en un regard larmoyant d’un baiser bien mélo. Et au moment où les deux bouches allaient s’unir, vous vous faites agresser par un zoom sur le dard d’une espèce rarissime de scorpion qui habite dans le désert sous les touffes de cram-cram. Alors que vous commenciez à vous intéresser malgré vous aux vertus piquantes de ces boules sèches, vous entendez la question fort épineuse de qui veut gagner des millions. Vous n’aurez pas le dernier mot, Louis de Funès est déjà en train de vous seriner que Monseigneur, il est l’or, l’or de se réveiller. Et effectivement, sursaut musical de Simple plan dans la pub de Citroën. Ce n’est pourtant pas compliqué, le mobile du crime ne peut être que l’héritage. 25 cm la minute et 150 SMS offert pour le premier mois de souscription. Un mois, c’est la durée de gestation du scorpion. L’autre pleureuse du mélo est maintenant en train d’éplucher son horoscope – ascendant agaçante.
Très amusant à écrire. Moins à lire, surtout quand cela s’étale sur une vingtaine de pages. Les images se succèdent, s’impriment, se fondent les unes aux autres, et au final, vous avez passé la soirée dans un puzzle d’images dont on imagine les manques et que l’on colle tant bien que mal à la suite en un nouveau scénario. L’entremêlement des voix tisse un récit et noue l’intrigue, mais là, c’est étourdissant. Il me tourne la tête. Il est épuisant. Il faudrait des conjonctions de coordinations. Des conjonctions de subordination seraient les bienvenues. Il faudrait vraiment. Ce hachis en pages grammage 90g, 12 cm par 19 cm, sur 476 pages, c’est beaucoup. C’est amusant pourtant. C’est étourdissant. Assourdissant. S’il vous plaît, monsieur Claude Simon, ne voudriez-vous pas demander à Kant de vous prêter quelques mots de liaison ? Vous n’êtes pas liés tous deux ? C’est fâcheux. Tentez Hegel, alors. A lui non plus, ça ne lui fera pas de mal d’apprendre en retour à arrêter le fil de sa pensée de temps en temps. Sur ce, filons. A l’anglaise si cela vous chante. Et si cela vous enchante, tant mieux. Le désenchantement n’est jamais bien loin.
- Les Géorgiques, Claude Simon, éditions de minuit
- Pas de connaissance précise de la gestation du scorpion, ni de l’opérateur à contacter pour l’offre mobile. Et je sais encore moins si la mélo a réussi à ne pas pleurer à son mariage. Quant à Louis de Funès, pas d’inquiétude, sa cassette est toujours bien gardée.
- PS après quelques pages supplémentaires de lecture : en fait, on s'y fait. On se fait au fait d'être dans l'incertitude. Puis l'écriture est assez virtuose. Affaire à suivre.
21:20 Publié dans Souris de laboratoire, Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (7)
26 août 2006
Paris,je t'aime.
Je l'ai vu, j'ai oublié de vous en parler. Alors voilà les petites pellicules tranches de tendresse à savourer. D'autant plus appréciable qu'avec l'amie qui m'a emmené au cinéma (Jiji!), nous nous sommes amusées en attendant la scéance, à observer les passants et à inventer l'histoire de leur vie.
Quand la ville lumière conjugue projecteurs et feux de l’amour de la passion, les Je t’aime tombent comme des pièces de monnaie. Chute tintante ou assourdie en un murmure. On en récupère en peu n’importe où, surtout dans les endroits incongrus. Les petites pièces de la comédie humaine s’enchaînent, rythme d’abord déroutant, puisque l’on voudrait se garder un petit instant pour rêver. Mais l’on s’adapte, et naviguer d’un univers à un autre devient un véritable jeu – de l’amour et du hasard. Il y en a de plus pour tous les goûts : de la douceur entre Nathalie Portman et son ami aveugle, jusqu’à une conversation acide entre un vieux couple divorcé, en passant par le doux-amer de l’homme qui se retrouve contraint d’aider sa femme atteinte d’un cancer alors qu’il voulait la quitter ; ou encore le morceau saignant du vampire séducteur (et qui m’a moyennement plût).
Impossible de citer tout et tous ce(ux) qui plaît(sent), mais dans ce grand patchwork où brièveté rime avec intensité , chacun peut picorer selon son goût. Il est néanmoins conseillé d’aimer la sauce british/american, parce que si Paris est bien la capitale française, le french kiss se décline en langue anglaise, qu’il soit question de mots ou de référence à (la tombe d’)Oscar Wilde :
“Deceiving others. That is what the world calls a romance” Dès lors, il n’est pas étonnant que l’art de l’illusion et l’amour fassent bon ménage !
15:23 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (6)
08 août 2006
Du côté de chez Proust
Il ne faut pas vouloir s’attaquer à Proust comme à un pavé échoué sur la plage dans sa migration vers l’île prépa. Lire à grande vitesse, c’est s’exposer à décrocher avant même d’avoir adhérer. Il faut au contraire s’y immerger et de même que nos mouvements sous l’eau semblent freinés et adoucis comme en apesanteur, la lenteur du rythme de lecture amène la rapidité dans la progression.
Qu’en ai-je pensé ? Je partais avec un gros a priori qui n’était pas pour servir l’auteur, à savoir que ce pavé n’était qu’un amas de longues phrases aussi ennuyeuses qu’Emma Bovary pouvait l’être. A la recherche du temps perdu ? Ne cherchez pas je l'ai trouvé, c’est de passer tant de jours sur ce roman. Ce genre d’idées qui sont aussi pensées que les rappels de mise un jour scandés par l’ordinateur.
Ai-je aimé alors ? Je n’en sais trop rien. L’histoire n’est pas passionnante en soi. Le narrateur me paraît même un peu geignard au début. Le style, s’il déborde de subordonnées n’est pas mélodieux en lui-même. Non, l’intérêt que j’y ai trouvé (sans prendre à ce que ce soit le seul valable) réside ailleurs. Dans la perception du réel. [Pas d’overdose de Merleau-Ponty, pas d’inquiétude – un certain intérêt –ok, beaucoup plus que pour Kant]. Proust a une façon tout à lui d’aborder le monde. Il ne cherche jamais à en être un observateur spectateur. L’extérieur se déduit de son intériorité, de la résonance qu’il a eue sur lui. Ainsi les descriptions ne sont jamais ennuyeuses puisqu’il n’y a pas de description comme on l’entend d’habitude. Vous ne feriez pas renter un morceau de Balzac sans que cela détonne, par exemple. Si j’osais mélanger allégrement les époques, je dirais qu’on s’approche des tropismes, ces petits riens qui sont à l’origine de changements quasi imperceptibles en nous (Ca c’est ma définition imprécise, pour quelque chose de plus consistant, rendez vous directement auprès de la principale concernée, c’est-à-dire Nathalie Sarraute, l’inventrice de ce néologisme.) L’ensemble est décousu, pas de fil directeur mais une succession de sensations qui s’imbriquent et finissent à coup de digressions et remarques en apparence anodines à esquisser une ambiance, modeler un caractère, recrée une sensation identique chez le lecteur.
J’en arrive à ce qui m’a littéralement (et littérairement) fasciné : les comparaisons. Du côté de chez Swann ressemble pour moi à une gigantesque boîte à images, des métaphores en tous sens qui colorent la vision usée que l’on a du quotidien [Je sais, ça sens Bergson d’ici]. Une saynète ou même un moment deviennent un instant magique suspendu dans le temps. Le genre de chose dont on se dit : « C’est tellement juste. C’est exactement ça. Même si je n’y avais jamais pensé. ». Et la madeleine ne me semble pas le morceau le plus savoureux, loin de là. Proust, je l’ai goûté par morceaux, comme on se régale de miettes en oubliant totalement l’aspect de la part que l’on vient d’engloutir. Et là, j’ai envie de reprendre le volume et d’y colorier les passages qui m’ont interpellés pour pouvoir les retrouver à loisir et m’offrir une parenthèse, comme un bonbon que l’on savoure avant de repartir de chez la tante ou la grand-mère. Oui, c’est décidé, je deviens collectionneuse d’images poétiques et impressions fugaces. Première vitrine, au hasard des pages sur lesquelles je suis retombée :
Tailladé dans la phrase… parce que je me sens comme chez mon arrière-grand-mère quand je hume cela :
« et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et «lever» la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense «chausson» où, à peine goûtés les aromes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée de couvre-lit à fleurs. » [Combray II ]
« Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d’un coup, sur sa pierre maussade je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une couleur moins terne, la pulsation d’un rayon hésitant qui voudrait libérer sa lumière. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et mille reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s’y poser. Un souffle de vent les dispersait, la pierre s’était de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisés, ils revenaient; elle recommençait imperceptiblement à blanchir et par un de ces crescendos continus comme ceux qui, en musique, à la fin d’une Ouverture, mènent une seule note jusqu’au fortissimo suprême en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l’ombre découpée de l’appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir comme une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblait trahir une conscience appliquée, une satisfaction d’artiste, et avec un tel relief, un tel velours dans le repos de ses masses sombres et heureuses qu’en vérité ces reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu’ils étaient des gages de calme et de bonheur. » [ Troisième partie du roman : Noms de pays : le nom ]
Aller, un dernier pour la route :
« Et il y eut un jour aussi où elle me dit: «Vous savez, vous pouvez m’appeler Gilberte, en tous cas moi, je vous appellerai par votre nom de baptême. C’est trop gênant.» Pourtant elle continua encore un moment à se contenter de me dire «vous» et comme je le lui faisais remarquer, elle sourit, et composant, construisant une phrase comme celles qui dans les grammaires étrangères n’ont d’autre but que de nous faire employer un mot nouveau, elle la termina par mon petit nom. » [idem]
Pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait morts, la lecture entière se trouve ici.
15:45 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (8)
24 juillet 2006
Je ne veux pas au conditionnel
Sortie de ma torpeur estivale par un stage de danse, je me suis mis au parfum avec l’aide de Süskind. J’ai réveillé mes sens en suivant les aventures sans dessus dessous en dentelle de Manon Lescaut. Charles Dantzig, avec son nom qui rings a bell du programme d’histoire de première, m’a rappelé que les neurones ont aussi le droit d’être alimentés. Et ce qui s’accorde parfaitement avec le caractère ludique qu’on est en droit d’attendre de ses vacances, on peut jouer avec ces nourritures. Pas de date de péremption. La seule indigestion possible se situerait du côté de la fatigue causée à nos yeux. Alors pour éviter l’éblouissement de la page blanche, je veux des chapeaux, des chapeaux circonflexes, des accents entraînants ; tous les accents circonflexes du plus-que-parfait du subjonctif. L’abbé Prévost eût pu en ajouter pléthore qu’il ne m’en eût pas lassée. Je veux manger du petit caractère avec excès de vitesse sans être arrêtée par une police biscornue. Je veux sauter sur les aigus et faire du toboggan sur les graves ; reprendre le rythme au point-virgule pour souffler sur la cédille ; fixer dans les deux yeux ce tréma éberlué puis m’en aller sur le point sans trébucher. Je veux des pages et des pavés, du sable tant qu’il est dans la mouvance de la lecture. Je veux tout avaler, des feuilles jusqu’à Racine : la langue piquante d’Oscar Wilde, les et pis tet’ épithètes de Balzac, les didascalies dada de Becket, les ronds dans l’eau de Virginia Woolf et les vapeurs alcoolisées d’Apollinaire. Je veux de nouvelles saveurs ; je veux que ça pétille, que ça croustille, que ça frétille. Que ça croque sous la dent, que ça s’effrite dans la mémoire. Que ça crapahute dans la culture, que ça moissonne les idées. Que ma caboche asséchée soit arrosée par la soif de lire.
13:42 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (4)