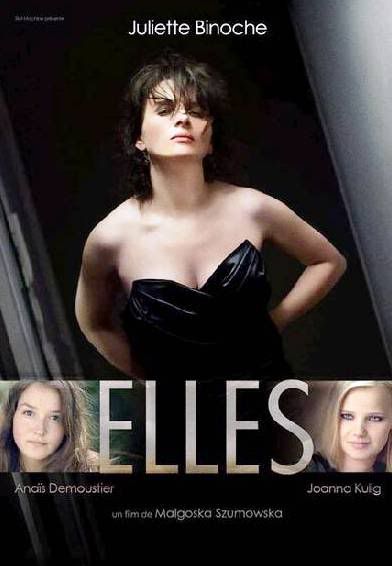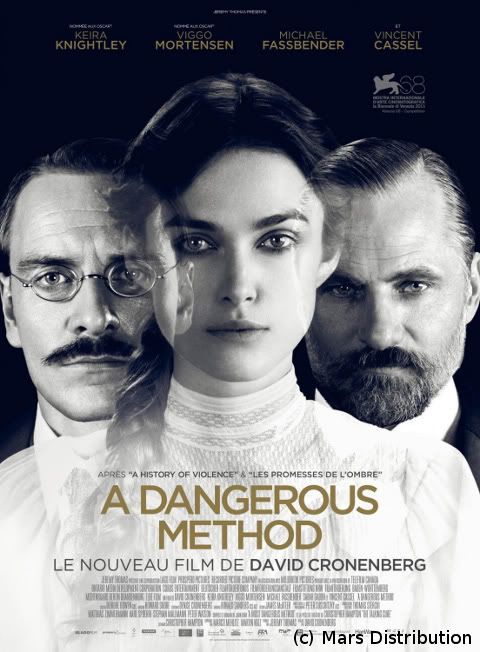16 février 2012
J. Edgar
Le FBI, du groupe parallèle parasite à l'institution tentaculaire.
Un homme assez peu sympathique, qui fait confiance instantanément, à l'instinct, et vire de même, à la gueule du client.
Son second beaucoup plus amène, pour amadouer le spectateur.
Une amourette de jeunesse esquissée, un enlèvement d'enfant, la vieillesse homosexuelle - faibles tentatives du film pour faire pièce aux intrigues politiques.
Une obstination qui force l'admiration et la détruit : soif de pouvoir. Réécriture de l'histoire : le procédé de falsification du vainqueur falsifié en humaine faiblesse.
Le second vieilli en lézard. Vérité nue du maquillage : trop de taches.
20:44 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma
15 février 2012
Elles
Elles n'est pas un film sur la prostitution estudiantine. C'est un film sur une rédactrice d'Elle (ou tout autre magazine féminin) qui fait un papier sur la prostitution estudiantine, nuance. Il ne s'agit donc pas tant de décrire une réalité que de montrer la difficulté qu'on peut avoir à l'admettre. Je dis on parce que même sans être une bourgeoise du XVIe arrondissement, je suis par les préjugés de mon éducation plus proche d'Anne, la journaliste, que de Charlotte et Alicjia, dont j'ai pourtant l'âge et le profil d'étude. Préjugés : pas nécessairement un jugement préconcu et moralisateur, plutôt une absence pure et simple de jugement. Ni pour ni contre la prostitution (contre le proxénétisme en revanche) a priori, je l'associe pourtant spontanément à une activité déplaisante. Une spontanéité à base de media et du jus de corps dans lequel on baigne dans le métro, probablement. Dans une rame, combien d'hommes supporterait-on comme clients ? Vu sous cet angle, le jeu de "qui est baisable ?" n'en reste pas un très longtemps...
Pourtant, les deux étudiantes, si elles ne prennent pas nécessairement leur pied à chaque fois, ne prennent pas pour autant leurs jambes à leur cou. Leur aplomb désarçonne Anne, qui s'était préparée à recueillir le témoignage (i.e. la complainte) de jeunes victimes et se retrouve face à deux business women bien dans leurs baskets. Le propos de Malgorzata Szumowska, la réalisatrice, n'est pas de dire que la prostitution est une activité idyllique (une scène complètement traumatisante où Charlotte se fait sodomiser avec le goulot d'une bouteille se charge de nous le rappeler tout en subtilité) mais de la réinscrire dans un contexte social dont on l'exclue un peu vite. D'ailleurs la scène traumatisante l'est presque moins pour Charlotte, que cela n'empêche ni de dormir ni de sourire (et de s'asseoir ?), que pour le spectateur, qui ne voit rien mais serre les fesses (entre ce film et la place mal placée d'Orphée et Eurydice, c'est dingue ce que la culture veut du bien à mes fessiers).
Ce qui la dégoûte, laisse sur elle une odeur qui ne part pas et lui donnerait presque envie de vomir, ce ne sont pas les pipes qu'elle taille à des hommes qui ont l'âge d'être son père, comme la juxtaposition des plans nous le laisse croire ; c'est la médiocrité qui colle, la saleté du HLM banlieusard dans lequel elle a été élevée, duquel elle s'est "élevée" jusqu'à une prépa, et dans lequel elle revient les week-ends, l'absence de l'argent, qui, elle, a une odeur... et les pulls en acryliques, ajoute-t-elle à l'intention d'Anne, très propre sur soie (spéciale dédicace à Palpatine, qui a la fibre compréhensive niveau textiles).
Un second plan sans transition se charge d'enfoncer le clou : Charlotte couche avec un jeune homme frêle qu'on suppose immédiatement être Thomas, son petit copain, tant la scène irradie de blancheur, depuis les draps et la peau du jeune homme jusqu'au sourire de Charlotte, lumineux comme l'immense fenêtre qui déverse sur eux une lumière béate. Ils finissent, elle lui tripote les cheveux, lui sort et compte les billets. Raté : Thomas, c'est le plan suivant et finalement, on se dit qu'on préférait le plan cul. Pour faire bonne mesure, Charlotte est soupçonnée d'être jalousement amoureuse du client ; elle lui pique son téléphone pour fouiner dans les numéros, mais ça ne va pas bien loin (jusqu'aux toilettes où elle s'enferme un instant - comme un caprice d'adolescente à la tristesse vite passée).
L'aplomb de ces filles dérange. Il dérange Anne. Il dérange l'ordre des choses. Ce serait si simple de les plaindre, pas besoin de se remettre en question. Avec son regard provocateur (plus racaille que femme fatale), Alicjia accuse sans sourciller celui de la journaliste. Elle prend un malin plaisir à défendre ses clients, ces clients qui sont "tes types normaux", insiste Charlotte, "pas des pôv' types", et à sourire de cette femme qui est du bon côté, du côté qui stigmatise. Quitte à se faire baiser par la société, Alicjia préfère encore s'asseoir sur son hypocrisie et se servir de son cul pour prendre de l'argent à ceux qui l'ont bordé de nouilles. Elle ne se laisse pas faire à son arrivée à Paris par le propriétaire qui consent à lui louer un studio à un prix modique pour peu qu'elle complète en nature ; elle ne passe pas non plus à la casserolle lorsqu'un étudiant sensible à ses charmes lui propose de l'héberger pour l'aider, mais on sent que c'est à partir de ce moment qu'elle décide de tirer profit de la situation ("tu dois avoir l'habitude, non ? Tous les mecs doivent avoir envie de coucher avec toi") avant qu'on ne profite d'elle.
Forcément, tout ça, quand tu habites un appartement assez grand pour que le traverser te suffise à prendre soin de ta ligne, que tu prends ta journée pour servir au dîner des coquilles Saint-Jacques* au patron de ton mari, et que tu balises grave parce que ton aîné aux cheveux en pétard vient d'en fumer un, c'est un brin culpabilisant. Encore plus que de ne pas avoir acheté des céréales bio et de laisser le cadet massacrer des pixels animés, c'est dire. S'il lui a été difficile d'entendre que les clients étaient des types normaux, c'est parce que ça pourrait être son mari, certes, mais aussi parce que si elle ne peut plus dire "ils", elle ne peut plus non plus dire "elles" ("qu'est-ce qui tu dis que ce sont des putes ?", finit-elle par lancer à son mari). "Elles", ce sont ces filles qu'on tient à l'écart -- de sa pensée mais aussi de la société. Société dont elle est une privilégiée.
[Elles... qu'on voudrait reléguer dans le coin de l'affiche]
Tout au long du film, Anne essaye en vain de démasquer la peine chez ses deux interviewées, et ce n'est pas faute de les avoir questionné sur toutes les craintes que la prostitution lui inspire. Seulement, quand on leur tend une perche, Alicjia et Charlotte s'en foutent. Anne s'en rend presque malade et finit par capituler ; ce serait tout de même un comble que la privilégiée soit la plus nevrosée de toutes. La moindre des choses est de savoir apprécier ce qu'elle a quand celles qui n'en ont pas le quart ne se font pas de noeud au cerveau. Tout ça finit par un petit-déjeuner qui n'échappe au Ricoré que par les traits fatigués mais sereins d'Anne et le portable consulté distraitement par son mari. Après la débâcle de la veille (et que je te plante en plein milieu du dîner, et que je revienne hagarde au milieu de la nuit, en me jetant sur toi), c'est joli mais un peu pompeux ; je m'attendais à chaque instant à l'entendre dire : « Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s'appelle l'aurore. » Mais plus que de renaissance, c'est un sentiment d'inachevé qu'Elles laissent, elles si parfaitement antithétiques, si parfaitement para-doxales. A prendre systématiquement le contrepoint du cliché, on finit par le détourer et le faire apparaître en creux.
Il n'y a donc qu'une seule chose qui m'a choquée, c'est que le film soit interdit aux moins de douze ans. On parle quand même d'un film où une fille entièrement nue assise sur un piano se masturbe les cuisses écartées avant de se faire prendre en levrette, et où on comprend sans le voir qu'une autre se fait sodomiser avec une bouteille en verre. Douze ans. Alors oui, on ne voit pas de sexe d'homme. Mais alors, quoi, une toison pubienne, comme il n'y a rien qui dépasse, ce n'est pas un sexe, pas besoin d'interdire aux moins de seize ans ? Y'a quelque chose qui me dépasse.
* Saint-Jacques gluantes, cuisinées à mains nues. Tout comme d'autres ingrédients peu râgoutants ou le massage des pieds qu'Anne fait à son père sénile. Ce constant pétrissage relativise celui de la chair auquel se livrent les deux étudiantes...
14:00 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma
12 février 2012
Le muet éloquent
The End. La mention apparaît plusieurs fois avant la fin de The Artist, comme pour faire sentir que la carrière de George Valentin prend fin bien avant que sonne la retraite. Cet acteur du cinéma muet refuse en effet de prendre le tournant du parlant et se laisse ravir (sa place) par Peppy Miller, une jeune première en pleine ascension.
Forcément, un film muet en noir et blanc aujourd'hui ne peut que parler des films muets en noir et blanc d'autrefois, pour trouver sa justification dans le fait d'être à l'image de son objet. Pourtant, The Artist est bien de notre époque ; son monde en noir et blanc est bien le nôtre, distinct de celui où l'on tournait dans les années vingt. Et si l'on a un peu peur les premières minutes en se disant que les mimes outranciers et les didascalies en flash infos1 vont demander un sacré temps d'adaptation, on découvre rapidement qu'il s'agit d'une mise en abyme où les traits du film muet ont été forcés à dessein. Certes, backstage George fait des grimaces et Peppy s'agite comme une folle, mais à la manière de celui qui fait le pitre la matin devant le miroir de la salle de bain (étendu à la journée entière puisque Valentin, un brin mégalomaniaque avec son portrait en pied à la Dorian Gray, se croit en permanence sous le feu des projecteurs) et de celle, girly, à qui l'on vient d'annoncer une excellente nouvelle.
Je craignais de la part de Jean Dujardin une légèreté de garçon de café. Il m'a surprise ; c'est un peu comme de découvrir que Jim Carey n'est pas que le bouffon de The Mask et peut très bien jouer dans The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Quant à Bérénice Bejo, son sourire et son peps suffiraient seuls à faire basculer le muet depuis le handicap vers le non-dit, avec la finesse d'implicite que cela suppose. L'absence de parole, loin d'être encombrante (on a finalement peu d'écrans brandis comme une ardoise de sourd-muet), redonne toute sa place aux corps ; on redécouvre que l'expression passe par mille et une nuances de la physionomie.
Outre la qualité de ses interprètes, The Artist regorge de trouvailles : rien que le chien de George, mi-Milou mi-chien de cirque, dressé à tomber raide mort au moindre bang en forme de pistolet, est tordant. Alors que toutes les bobines de ses films sont par terre et que le projecteur tourne à vide, la déprime alcoolisée de George fait apparaître sur un écran blanc une ombre qui prend son autonomie et vient invectiver son propriétaire.
Cela m'a fait penser à la fin du Procès d'Orson Welles. C'est un des seuls films un peu anciens que je connaisse mais je suis sûre qu'un cinéphile s'amuserait à trouver moult références. Pour autant, ces clins d'œil n'excluent personne et l'on peut très bien s'amuser du premier niveau sans rien connaître au cinéma américain de l'entre-deux-guerres. Il en est ainsi des différentes prises d'une scène où l'acteur perd le fil de son texte à valser quelques instants avec la nouvelle figurante, Peppy, revisitant sur le mode méta le comique de répétition.
Mais la méta-tranche de rigolade que je me suis payée, c'est lorsque George rêve que le cinéma parlant, en l'excluant, lui a pris la parole : aucun son de sort de sa bouche, comme depuis le début du film, normal, mais le verre qu'il repose sur la table, lui, émet un tintement. Le personnage est éberlué, la salle morte de rire. S'ensuit une scène où ses hurlements silencieux face au miroir sont couverts par les bruitages amplifiés des objets qu'il jette par terre de colère. C'est ainsi que lentement, nous passons au parlant... sans paroles superflues, néanmoins, puisque c'est le bruit des claquettes qui anticipe le crépitement des applaudissements retrouvés pour notre star du muet.
10:50 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma
06 février 2012
A dangerous method
Encore un compte-rendu qui a failli passer à la trappe parce que je ne sais pas par quel bout le prendre. Ce serait simple si A dangerous method n'était que l'histoire de Sigmund Freud et Carl Jung, et que l'histoire était linéaire, donnant un coup de vieux au maître dépassé par son disciple. On admet sans difficulté les limites de la psychanalyse, envisagée par son fondateur comme une science. Intuition de génie, interprétation intelligente, efficacité médicale, oui, sans conteste, mais une science ? Cela me fait penser aux chercheurs littéraires qui ne peuvent se satisfaire de sérieux, de pertinence et de rigueur, et veulent à tout prix que leur travail soit validé par le label « scientifique », comme s'il était synonyme d' « universitaire ». Les hypothèses de Jung dérangent Freud qui se retranche dans son système, dont la cohérence semble établie pour résister contre la critique davantage que pour répondre aux problèmes que l'on n'avait pas rencontrés lors de son élaboration. Quelque part se fait entendre la petite voix de Rouletabille s'adressant à l'inspecteur Freud Fred Larsen : « C'est un système bien dangereux, M. Fred, bien dangereux pour certains policiers qui consiste de partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver ensuite aux preuves dont vous avez besoin. »
Pourtant, tout comme l'inspecteur, Freud a ses raisons pour laisser dans l'ombre les pulsions mortifères. Cela pourrait être dangereux. Pour son statut (le docteur qui sait et soigne) mais il le pressent aussi, pour sa personne. Il s'en tient donc au plaisir car le plaisir est scandaleux mais il n'est pas dangereux – tout juste ennuyeux quand on se coltine déjà une famille nombreuse (frustré, le docteur Freud ? – non, il reprendra juste un cigare).
L'homme qui ne cherche que son plaisir, c'est un confrère que Jung reçoit comme patient et qui connaît le contre-transfert comme le corps de ses patientes – en l'absence de celles-ci, l'infirmière fera très bien l'affaire. Il embarrasse parfois d'un enfant mais n'a rien d'un fou furieux. Il dérange pourtant – la société bien-pensante, assurément, mais aussi le docteur qui se met à douter du bienfondé qu'il y a à ne pas suivre aveuglement notre propension au plaisir. Jung est séduit par le discours de son patient mais quelque chose en lui résiste, qui n'est peut-être pas uniquement dû à son éducation dans une certaine société. De fait, le patient disparaît ; il laisse une lettre demandant qu'on le fasse passer pour mort auprès de son père, comme si l'on ne pouvait à la fois être soi et tout au plaisir. Risque de dissolution de la société (tout ces enfants sans père...) et de son identité, qu'il faudrait à chaque fois abandonner : ce n'est plus de plaisir dont on croit entendre parler mais de pulsions.
Jung va faire l'expérience de ce que le désir n'est pas uniquement désir de plaisir. On arrive au cœur du film, à l'intrigue principale dont je n'ai pas encore parlé. Cela peut paraître paradoxal mais les intrigues secondaires sont essentielles car la charge compassionnelle de Jung et l'attente d'une romance par le spectateur sont si fortes qu'elles masquent la nature de la relation qui se développe entre le docteur et sa patiente. Il faudra l'aide de tout ce qui se passe à côté pour mettre progressivement cette histoire centrale de côté.
Sabrina Spielrein est une hystérique comme seul le XIXe siècle a su en produire. Amenée manu militari à l'hôpital, on se dit d'abord que Keira Knightley en fait un peu trop. Pourtant l'acharnement qu'elle met à détruire son image austenienne force l'admiration ; ses tics nerveux et ses grimaces simiesques en font une proie apeurée à défaut de laide. Assis derrière elle (qui ne fait donc face qu'à elle-même), Jung parvient au fil des séances à la traiter, c'est-à-dire d'abord à la traiter en personne saine d'esprit et non en débile mentale. Ce présupposé est radicalement à l'opposé de ce qui finit par me déranger, l'impression que la psychanalyse créé ou du moins maintient la névrose en cherchant toujours à la débusquer. À ce stade, cependant, l'analyse est efficace, elle permet à Jung de remonter à la racine du mal.
Suite à une promenade où il a dépoussiéré de quelques coups de canne le manteau de Sabrina tombé par terre et où celle-ci a brusquement été reprise de panique par ses tics, le docteur fait identifier à sa patiente l'origine de ses symptôme : enfant, elle était enfermée dans une petite pièce pour être battue par son père et c'est honteuse qu'elle a découvert le plaisir – ou plus exactement l'excitation puisque c'était loin d'être une partie de plaisir. La perversité qui vide les mots de leur sens (plaisir, souffrance ou excitation ?) et transforme le soulagement de la masturbation en automutilation honteuse nous laisse loin de la fessée rousseauiste. L'excitation est déjà un mécanisme fondamentalement étrange, réglé de façon arbitraire (pourquoi l'excitation se déclenche-t-elle face à une femme et pas un oiseau ou autre chose, après tout, se demande Kundera) mais si en plus cet arbitraire est déréglé, on n'est pas sorti d'affaire. Toute la sexualité de la jeune femme (vierge) s'est construite sur cette association du plaisir à la douleur et l'humiliation et le partage entre le normal et le pathologique s'avère plus difficile à opérer qu'on ne l'aurait cru. En témoigne ce geste que Sabrina ne cesse de faire, poing glissé entre les cuisses serrées, et que je ne comprends que lorsqu'elle avoue son excitation : j'aurais pourtant dû le reconnaître, c'est peu ou prou celui par lequel commence le pas de deux final du Parc de Preljocaj. Mais quelle ressemblance quand dans un cas le corps se rétracte et de raidit tandis que, dans l'autre, il se relâche et s'abandonne ?
C'est devant cette ambiguïté qui se propage à tout ce qui entoure Sabrina, Jung et Freud, cette ambiguïté plus proche de la confusion que de l'érotisme, que j'ai failli renoncer à entreprendre une critique (analyse serait malvenue, je suis totalement novice en la matière). Je ne sais pas si c'est une étrangeté mais elle est sans conteste inquiétante. Je me suis retrouvée à être toujours d'accord avec celui qui venait de parler le dernier ; cela avait moins à voir avec une quelconque dialectique qu'avec le manque de discernement qui faisait qu'enfant, je ne comprenais pas que la personne qu'on critiquait, à juste titre pensé-je, puisse être celle que j'avais à tout aussi juste titre bien jugée. Je voyais bien qu'aucun élément n'était faux sans comprendre que la vérité ne se trouvait qu'en les tenant ensemble ni imaginer qu'elle résidait précisément dans la résolution de la contradiction. Mais Jung en bave, à essayer de concilier ses vues sur Sabrina avec celles de Freud.
Ensemble (car pour porter plus loin la confusion entre analyste et analysé, la jeune femme se pique elle aussi de psychanalyse), Jung et Sabrina vont (se) chercher jusqu'à se perdre (dans une relation adultère, la femme de Jung étant enceinte de son amour). Ce dont ils ont l'intuition aboutit à une hypothèse radicalement opposée à celle de Freud : le désir ne serait pas une tendance vers le plaisir mais une pulsion de destruction. Et de vérifier cela par les travaux pratiques qui s'imposent, une petite séance de sadomasochisme.
On ne voit pas grand-chose mais ce n'est pas fausse pudeur si la caméra filme la scène par le biais d'un miroir. Sabrina, attachée (pour ne pas s'égarer ?), vient y chercher son reflet comme pour se retrouver, trouver dans son image l'occasion de se ressaisir, de se fondre avec cette image et non avec l'homme qui s'oublie avec elle.
J'ai été frappée par cette idée que la fusion, qu'on associe souvent à la création (un enfant, dans le cas des corps qui s'étreignent), soit aussi et avant tout une destruction. Ce qui explique pourquoi on a sacrément intérêt à faire attention avec qui (et non à qui) l'on s'abandonne – après la bien dénommée petite mort, il faut une personne de confiance pour nous ramener à nous. En l'occurrence, Sabrina et Jung ont beau être des êtres moraux, ils ne sont pas moralement assez fort pour s'arracher l'un l'autre à cette pulsion de destruction, dont ils ont entrepris ensemble l'exploration. C'est Jung qui va le comprendre et se faire violence pour se détacher de celle à qui il s'est attaché et qui l'entraîne vers les profondeurs. La patiente souffrira une fois encore, une dernière fois, c'est dans son rôle, et cessera enfin d'attendre la guérison de celui qu'elle met en position de la faire souffrir. Pour être guérie, il faut qu'elle cesse de chercher le docteur, comme si la psychanalyse ne guérissait que si l'on en sortait (en sortir, si proche de s'en sortir – preuve que l'analyste n'est pas un magicien, il ne découvre rien mais fait découvrir à l'analysé qu'il guide). Jung, lui, n'en sort pas indemne ; en tant que docteur, il s'est ressaisi, mais il a laissé une part de lui-même dans l'affaire. L'amour qu'il porte à sa femme et à ses enfants n'a jamais cessé d'être sacré pour lui et il est probablement un époux et un père heureux – mais un homme en proie à la dépression. Une méthode dangereuse, vous disait-on.
[La confusion des sentiments et des idées s'affiche d'entrée de jeu. Beaucoup plus réussi que la version italienne qui (g)lisse du côté de la simple séduction.]
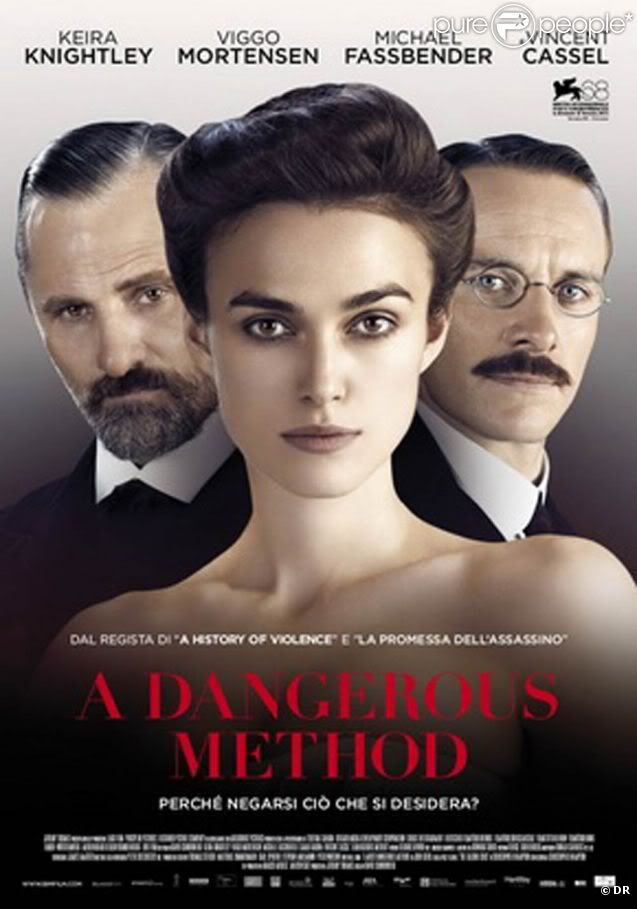
[Il s'est si bien fondu dans son personnage que je ne me suis rendu compte qu'à la fin que c'était lui. Michel Fassbender, décidément.]
18:02 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma