03 octobre 2009
Wozzeck hören oder sehen ?
Mercredi dernier, Palpatine a pris la chose en main (i.e. moi et le gouffre me servant de culture musicale - métaphore habituellement réservée au cinéma, mais ça marche aussi) et m’a traînée à l’Opéra pour voir… un opéra. Ca paraîtra logique à beaucoup de monde, mais je n’y ai jamais vu que des ballets. Et le seul opéra que j’ai vu auparavant, c’était la Flûte enchantée au château de Vaux-le-Vicomte et il y a avait un peu de danse dans la mise en scène. Wozzeck, d’Alban Berg, c’était donc sinon une grande, du moins une petite première pour moi. Après la course pour gagner nos places de balcon obtenues à la dernière minute (enfin, à l’avant-dernière pour être exacte ; je n’ai pas encore reçu mon Pass jeune, parce qu’il paraît que mon adhésion à l’Arop n’avait pas encore été prise en compte – ne pas se demander pourquoi j’en ai reçu un mail le lendemain), il a fallu atterrir. Et là, force est de constater que je ne sais pas vraiment écouter et de reconnaître que l’oreille, ça s’éduque. J’ai mis un certain temps à synchroniser la lecture du prompteur avec l’écoute du texte allemand, et, tout en observant la mise en scène, à pouvoir entendre simultanément, quoiqu’en les distinguant, les voix et la musique. C’est un peu comme en danse, où il faut apprendre à désolidariser le haut du bas du corps afin de pourvoir ensuite coordonner les deux.
A la fin du premier acte, je commence à trouver mon rythme de croisière (gardez vos sarcasmes, je suis une cruche, ça sonnerait creux). De retrouver un peu d’allemand y aide bien : au tout début, impossible d’isoler des mots distincts dans les phrases prononcées ; puis en m’aidant du prompteur en français, je devine à retardement (rot – blot- tot, comme le refrain d’une comptine – oui, bon, je n’ai jamais été bilingue, hein, et c’est fou comme on perd vite en deux ans) ; à la fin, avec un coup d’œil en diagonale au prompteur, je devine par avance (« dunkel », yes ! – je sais, je m’amuse vraiment de pas grand-chose). N’empêche que ça me donne envie de refaire de l’allemand – pas au point de trouver les amphis à la fac, cela dit, faut pas déconner non plus.
Je ne connais rien à la musique ; je la ressens, je peux danser parfaitement en mesure (enfin presque, la plupart du temps, dirons-nous), mais l’écouter tout simplement, en restant immobile, j’ai du mal, la vision m’encombre. Tandis que la musique passe très bien en mouvements et que je pourrais presque dire que je l’écoute avec tout mon corps, mon oreille se perd dans les rythmes, la mélodie, la diversité des instruments, et le vocabulaire qui me permettrait d’identifier tout cela me fait cruellement défaut. Il m’est donc impossible de vous parler de cet opéra proprement dit - de dire que cela m’a paru… étrange n’avance strictement à rien.
Heureusement, même si les voix ajoutent à la difficulté de l’audition, Wozzeck est tiré d’une pièce de Büchner et l’intrigue, étant bien plus qu’un prétexte à la musique, permet à la novice (le mot technique pour « cruche ») que je suis d’entrer (un peu) dans cet opéra. Je ne vous ferai pas de résumé de l’action, vous trouverez cela ici si cela vous amuse, et ne me livrerai pas à un décorticage dans les règles, d’autant que ma paresse vous dira qu’il a déjà été mené à bien là (un petit extrait pour la route pour ceux qui ne cliqueront pas : « Œuvre de la déliquescence jusqu'à la perte au sens Absolu de soi, Wozzeck explore tous les travers imaginables du faillible, de la pauvreté et de la misère humaine, sachant que pauvreté et misère ne nous adviennent pas toujours que par le statut social. Ce qui y est perdu est précisément l'Absolu sans lequel la vie ne peut se faire. » - tant qu’on est dans le repiquage, je garde la formule d’ « opéra de l’absurde » de Palpat' ) Il est d’ailleurs curieux de constater que cette fan d’opéra se lance dans une analyse de la pièce plus que de l’opéra (je schématise, bien sûr) – même si la musique doit certainement forger la perception que nous avons de l’ « histoire ». Ce doit être en partie parce qu’on ne fait pas sangloter les violons que le drame de Wozzeck peut être intense sans virer au pathétique pour autant. La mise en scène y contribue aussi par la banalité qu’elle expose : la caserne a été transposée en une grande cantine, derrière les vitres de laquelle des gamins s’agitent pendant quasiment toute la durée du spectacle. Je n’ai pas pu de m’empêcher de me demander d’où ils sortaient, si leurs déplacements étaient réglés (pour certaines entrées cela ne fait aucun doute), s’ils s’éclataient vraiment à courir partout sur scène et à sauter dans le trampoline gonflable ou si, justement, ces jeux réitérés chaque soir les gonflaient. Ah oui, je n’ai pas non plus capté pourquoi un pianiste restait planté côté cour sans jouer, à allumer et éteindre une lampe à des moments dont lui seul pouvait savoir qu’ils étaient clés. Questions pour le moins aussi existentielles que celles qui se posent à Wozzeck. Aussi curieuse (déplacée ?) la mise en scène soit-elle (et encore, apparemment, ils se sont calmés sur les couleurs par rapport à la dernière fois où il a été monté à Bastille), avec ce décor à la banalité étroite, « à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie – et c’était peut-être pire-» * de cette cantine aux allures de hangar, la folie de Wozzeck s’expose sans exploser. A part un vol de chaussures dans lesquels l’amant (un bien grand mot pour un simili punk avec du bide, sur qui Marie n’a sauté qu’une fois avant d’implorer la Sainte éponyme de lui pardonner) a shooté, pas de cataclysme : c’est au milieu d’un décor immuable que Wozzeck implose.
Après la vidéo (d’époque, donc de piètre qualité) de la scène de la folie de Giselle par Olga Spessivtzeva … vers laquelle B#2 m’a envoyée, on pourrait se demander si la folie est si reconnaissable que ça, tellement plus inquiétante de ne pas être surjouée ; la raison qui se décompose d’elle-même sans grand éclat. C’est malin, maintenant je n’ai plus qu’à lire L’Histoire de la folie de Foucault (auquel cas vous pourrez faire une pétition pour ne pas avoir de post là-dessus).
C’était la critique chaotique d’une souris décontenancée. Inquiétez-vous, ce n’est pas fini.
* Melendili aura reconnu Perec.
21:15 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : opéra, bastille
24 octobre 2008
Prise de la Bastille par le New York City Ballet
J’ai avalé gloutonnement quatre soirées de ballets et n’ai pas même pondu un bref post. Cela vous a peut-être évité une indigestion suite à une omelette géante, mais tout de même, le New York City Ballet ne vient pas tous les quatre matins. Un mois déjà – les chorégraphies s’estompent pour laisser en souvenir des impressions et des flashs éblouis- mais je vous invite à faire le pique-assiette et à goûter à tous les plats.
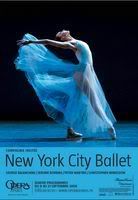
Avant le spectacle…
… entendre ses talons claquer, apercevoir les gens en train de grignoter un sandwich, qui semblent habiter là, et entendre la sonnerie à l’entracte…
… l’odeur du programme, dont l’encre ou le papier, je ne sais pas, ne semble être utilisé que par l’opéra de Paris. Une splendide photo de Sérénade dessus – heureusement, ils ont cessé leurs essais de trucs conceptuels à tentative pluridisciplinaire.
… le réglage des jumelles, pour espionner en toute bonne conscience les musiciens déjà dans la fosse, les violonistes qui discutent ensemble avec enjouement, un jeune homme situé dans la région des instruments à vent et qui semblait s’ennuyer ferme, un moins jeune dont maman n’a pas réussi à voir s’il avait une alliance à la main…
… former une haie de déshonneur pour ceux qui arrivent un peu tard…
… saluer avant qu’il ait rien fait le chef d’orchestre, comme pour se dédouaner de n’y plus penser par la suite…
En pleine apnée…
Divertimento n°15
Chorégraphie de Balanchine sur du Mozart
Des costumes un brin vieillot avec des couleurs un brin violentes (même si je n’ai rien contre le turquoise fluo dans l’absolu), mais la chorégraphie est tout sauf poussiéreuse. Les photos peuvent être trompeuses parce qu’elles prennent toujours les instants structurés, les lignes harmonieuses et les symétries impeccables alors que tout l’intérêt est justement dans la déstructuration, le jeu sur les formations et reformations, les décalages, les groupes, duo, solo, trio où les partenaires se dédoublent pour qu’aucun duo ne soit en reste… Virtuose peut-être, mais avec goût.
[Et puis je ne sais où, un sourire comme je n’en avais jamais vu. Charme sûr de lui mais surpris d’être découvert.]
Episodes
Chorégraphie de Balanchine sur une symphonie de Webern
La musique est déconcertante, presque discordante de prime abord, mais la chorégraphie a tôt fait de nous la faire écouter – et plus seulement entendre. Justaucorps noirs et collants blancs, le plaisir des lignes cassées, une géométrie pour les yeux.
Tchaïkovsky Suite n°3
Chorégraphie de Balanchine sur… du Tchaïkovsky, vous vous en seriez douté.
Une première partie en robes roses et violettes cheveux détachés, une seconde en tutus plateaux. Entre deux le soulagement de ne pas en rester à un élan kitsch.
Sérénade
Chorégraphie de Balanchine sur Tchaïkovsky
Le rideau se lève sur une forêt de danseuse en sixième, face au public, la tête côté jardin qui regarde vers une main paume tendue dans la même direction, poignet cassé.

C’était le ballet que j’avais envie de voir. Celui dont on voit des photos partout, avec ces grandes jupes fluides et une vague auréole romantique. Même là, Balanchine ne réussit pas à faire du mièvre : il y a toujours une énergie folle – des réminiscences de danses guerrières géorgienne, m’apprend le programme.
Les danseuses semblent petites – du coup jamais de bras arachnéens mais un concentré d’énergie, bras et jambes qui tranchent l’air avec violence, sans pourtant altérer l’ambiance de douceur qui s’est installée sur le plateau.
Symphony in Three Movements
Balanchine sur une musique de Stravinsky
Une terrible joie et de la force. Ca éclate, déboule en tous sens, saute avec enthousiasme - les pieds en blancs des garçons en collants noirs sont autant de notes en négatifs qui viennent suspendre en l’air une partition exultante. Des duos en rose et noir. Et toujours d’immenses queues de cheval qui donnent un air d’amazones gymnastes à cette immense diagonale de filles, qui se dressent par le même mécanisme. Une grandeur imposante, renforcée par la perspective des tailles – lorsque la colonne se déroule, on découvre que les amazones du fonds font une tête de moins que celles du premier plan.
Brahms/Handel
Chorégraphie de Twyla Tharp et Jerome Robbins
Verts et bleus, les corps coulent, fluides. Des courants calmes mais à la vigueur sûre, aux nombreux revirements sans aucun débordement. Des portés ahurissants qui ne semblent même pas académique… assez insaisissable. Une des principals, Sara Means, d’une grande classe.
Première chorégraphie qui n’est pas de Balanchine et moyen d’observer ce qui relève de la chorégraphie et ce qui relève des danseurs… du moins, je le croyais. Parce que ces derniers son tellement imprégnés de Balanchine, qu’il est pratiquement impossible de faire la distinction. Autant chercher comment la Berma magnifie ses vers.
Duo Concertant
Chorégraphie de Balanchine sur une musique de Stravinsky
Le piano est sur scène, le violoniste aussi. N’oublions pas le couple de danseurs, embusqué derrière le piano. Qui écoute rêveur et reviendra souvent tâcher de rêver – mais plus sûrement de reprendre son souffle. Avec cette mise en scène- à proprement parler-, le spectateur est obligé de sentir la musique et son lien avec ces pas joueurs et flex qui viennent en cascade.
Surtout dans une scène noyée dans l’obscurité, l’image d’un cercle de lumière où vient se créer une main, un mouvement, apparaître un visage et disparaître le corps en son entier. D’accord, Malliphant n’a pas tout inventé (mais sur ce coup-là, je préfère Malliphant).
Hallelujah Junction
Chorégraphie de Peter Martins sur une musique de John Adams
Avant toute chose, il y a, suspendus au fond de la scène, dans un arrière-plan onirique –mais noir- deux pianos face à face, deux pianistes éclairés par deux lumières qui sculptent le reste d’obscurité en deux diagonales croisées. Un voile noir a beau être interposé entre les pianistes et les danseurs, il se dégage tout de même une force folle de ce curieux orgue moderne.
La chorégraphie, en notes blanches et noires, mêle les décalages, contrepoints et canons. Tout est toujours en tension, même les huit tours de Daniel Ulbricht, même les dessins géométriques qui sont étirés comme s’il s’agissait d’élastiques tendus au maximum.
After the rain
Chorégraphie de Christopher Wheeldon sur Arvo Pärt
Comment donner le degré de mon engouement sans verser dans l’enthousiasme délirant ? Passé les trente premières seconde où il m’a fallu me défaire de la chorégraphie que j’avais dansé sur cette musique-là – de Dos Santos (ou quelque chose comme cela)- et m’accoutumer à la grande maigreur de Wendy Whelan (qui fait corps avec Sébastien Marcovici), c’est magnifique merveilleux magique poignant ? On oublie totalement qu’il s’agit de danse, qu’il y a une chorégraphie que les deux interprètes ont du apprendre et travailler, et on laisse se laisser hypnotiser par ce temps de vie. Corps noueux et cheveux détachés comme un feuillage – liane- attachement – duo racinien.
[Faites taire les deux imbéciles derrière qui assassinent déjà la chorégraphie la résonnance de la dernière note à peine évanouie.]
Dances at a Gathering
Chorégraphie de Jerome Robbins sur des Mazurkas, Valses, Etudes, Scherzo et Nocturne de Chopin
Au siècle dernier, celui, intemporel, de la nostalgie et du souvenir, une rêverie sur des rencontres amicales, espiègles, amoureuses, fraternelles, passionnées, attendues, retardées, déclinées, qui n’ont peut-être jamais eu lieu ou alors d’antan, déjouées mais rejouées sur scène… Apaisant mais pas lénifiant ; subtile, plein de vie et de finesse, cela glisse, fluide comme les robes des jeunes filles, jusqu’à la fin où les danseurs se tiennent immobile face aux spectateurs mais regardant bien plus loin, comme à travers eux.
[Dit comme ça, ça a l’air kitschissime, mais je vous assure que ce n’est pas le cas, que l’on s’amuse à retrouver tel danseur avec telle ou telle partenaire (je crois que c’était pour la danse d’Ashley Bouder que j’ai eu un faible, et pour Amar Ramasar), à voir les couples se reformer, et à surprendre des clins d’œil d’humour]
Carousel (A dance)
Chorégraphie de Christopher Wheeldon sur « The Carousel Waltz » et "If I love you », Richard Rodgers
Ambiance foraine, guirlandes aux tringles et triangles rouge dans les fentes des jupes violettes. Benjamin Millepied (après Petipa, avouez que c’est un nom qui claque pour un danseur !), formidable forain. Et surtout ce manège qui n’a jamais si bien porté son nom, où les cavalières sont devenues chevaux de bois, et, une barre dorée à la verticale, galopent sagement par monts et par vaults.
Tarentella
Chorégraphie de Balanchine sur une musique de Louis Moreau Gottschalk
Pittoresque si l’on s’arrête aux costumes. Virtuose sans aucun doute. Feu d’artifice (et) d’artifices techniques. On ne compte plus les tours ni ne peut nommer les entrepas qui s’enfilent en un rien de temps – en moins de temps que cela encore- semblent devancer la musique. Megan Fairchild et Joaquin De Luz sont époustouflants et brillants. Pas un étalage technique comme raillent d’autres charmants voisins de derrière, mais une grande éclaboussure d’énergie riante.
Barber Violon Concerto
Chorégraphie de Peter Martins
Deux couples qui se répondent : un classique pur, pointes, chignon banane, brillant à l’oreille pour elle, chemise bouffante pour lui, grande classe ; un plus contemporain, robe toute simple et queue de cheval pour elle, collants pour lui. Le classique qui par d’amples mouvements, nous donne un beau pas de deux (image du couple de dos, croisés en grande fente) ; le contemporain plus ancré dans le sol. Puis classique et contemporain dans une drôle de juxtaposition où les couples dansent côte à côte sans se voir, se croisent en des trajectoires qui s’évitent… on voit où la chorégraphe veut en venir mais la mayonnaise met du temps à prendre (et ce n’est pourtant pas faute d’ingrédients alléchants). Enfin, les deux pas de deux de la dernière partie ou les couples se sont dissociés : tout d’abord celui passionné du contemporain (Albert Evans) et de la classique (Sara Means – cette fille est la classe incarnée) à qui l’on semble d’abord faire violence, dont la retenue résiste, et qui finit, les cheveux dénoués, par s’abandonner totalement à son nouvel amant. Quant au classique (Charles Askegard), que l’on pouvait penser être resté seul aux prises du désespoir d’avoir perdu son élégante moitié, il est surtout aux prises de la contemporaine (Ashley Bouder), véritable petit morpion qui a résolu de ne pas lui ficher la paix. Un drôle de combat s’engage alors, où tous les coups sont permis – et hop, que je te file entre les jambes- y compris les attaques par derrière – le petit morpion collé au dos de sa proie et la déséquilibrant, c’est un nouvel Janus que l’on voit traverser la scène. Inégal mais finalement réjouissant.
West Side Story
Chorégraphie de Jerome Robbins, musique de Bernstein
La comédie musicale condensée à ses passages dansés. Mention particulière à Gretchen Smith (si je ne me trompe pas) véritablement endiablée. Et dans les scènes de rue entre les deux gangs (les sauts, gosh !) c’est du pur délire… comme dans le public en fait.
No doubt, « I like to be in Amer-i-ca ! »
16:26 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : danse, ballet, chorégraphie, bastille, new york city ballet, wheeldon, balanchine



























