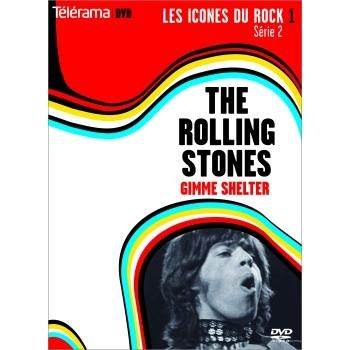28 octobre 2010
Le petit ailleurs de Louis Garrel
"- Le Petit tailleur, ça me dirait bien.
- Hum ?
- De Louis Garrel.
- Grumpf.
- Cela ne dure pas bien longtemps...
- Grumpf.
- Y'a Léa Seydoux.
- Il faut que je vois ce film.
- Tu vois qu'on est fait pour s'entendre."

La Nouvelle Vague à l'âme
Malgré toutes les références aux années 1950-60 que je laisse le soin aux cinéphiles chevronnés de trouver, le moyen métrage de Louis Garrel n'est pas un film d'époque, ni de celle de la Nouvelle Vague, ni vraiment de celle d'aujourd'hui, dont tous les éléments qui permettraient un ancrage par trop agressif ont été gommés. Cela aurait aussi très bien pu se passer ailleurs que dans la capitale, si Paris n'était justement cet endroit fantasmé qui n'existe nulle part. Le temps et le lieu ne relèvent ici que du conte, qui cisèle son histoire dans une fascinante miniature (petit tailleur, quelques quarante-cinq minutes).

D'ailleurs, l'histoire est surtout histoire de filmer de belles images ; presque juste de belles images, mais justes : des gestes. Ceux du tailleur, les mains rassemblées autour du travail de l'aiguille, qui lui donnent la posture humble d'une vieille personne, comme ceux qu'Arthur, l'apprenti tailleur, porte à Marie-Julie. On prend la mesure de son amour lorsqu'il prend celles de son corps endormi, le drap froissé autour des hanches, une exploration au mètre, sous toutes les couture, avant de confectionner une robe de main de maître. Il l'habille de son regard et de son désir, d'une robe banche avec des bandes noires, graphiques, rendant plus cruel encore qu'un autre la déshabille (Arthur ramasse la robe, reprend son amour).
J'adore la scène où il la détaille ; la caméra filme son visage à elle et il énumère : la bouche, le nez, un œil, un autre œil ; puis la caméra ne donne vie à son blason surréaliste, reproduit chacune de ces parcelles (l’œil, on dirait une photographie de Man Ray) et donne raison à Arthur, il ne peut la voir en entier, quand bien même l'entier serait résumé dans le visage aimé. Pour la voir, il ne lui faut pas la voir, mais la recomposer par l'imagination – perception étrangement juste : il l'imagine.
Il faut dire que la jeune comédienne lui en fournit la matière. On ne la voit jamais jouer et pour cause : sa comédie commence hors-scène, dans la mise en scène tragique de son existence. Car, à y bien regarder, ce n'est pas au film qu'il faut reprocher de poser, mais bien à Marie-Julie, immobilisée de profil, la figure en pleurs, l'essence de la fille triste.

Le cinéaste, lui, se contente de faire une pause sur cette attitude ; tout le film n'est qu'un écrin pour un moment vécu en dehors de la vie - mise en pause-, en dehors de sa course précipitée : l'épisode commence et s'achève par les cavalcades furieuses d'Arthur qui se rend au théâtre, la première fois pour assister au spectacle, la seconde pour y manquer Marie-Julie, repartie avec son fiancé, qui doit l'aimer lui aussi, pour passer outre ses caprices indécis.
Ce n'est donc pas par pur caprice qu'on nous refuse l'accès au théâtre, même si on entend quelque chose de la répartie enfantine dans « Le théâtre, soit on y va, soit... on n'y va pas. » , même si l'expédient de filmer « pendant ce temps » ce qu'il se passe ailleurs, d'errer dans les rues ou les bars, est plein d'humour : il ne faudrait pas croire que Marie-Julie tienne quoi que ce soit de la petite Catherine de Heilbronn (hormis le rôle – à la limite, Arthur serait davantage une petite Catherine défaite). Alors que l'héroïne de Kleist finit, par la force et la pureté de son attachement, par inspirer l'amour à l'homme auquel elle s'est mystérieusement accrochée, celui de Marie-Julie ne peut que rapidement expirer puisque cet amour n'est rien d'autre que celui d'Arthur - elle est tombée amoureuse de son rôle d'amoureuse. La petite Catherine n'impose rien (que sa présence) ; la future grande comédienne exige Arthur à ses côtés, veut l'arracher à sa vocation pour qu'il devienne un miroir parfaitement lisse.

Dès lors, le choix entre Marie-Julie et Albert, le maître-tailleur, n'est pas un choix entre l'amour et le métier (deux formes de passion, en somme, si le métier est entendu comme vocation), mais entre l'amour-passion et l'amour-relation. Avec Marie-Julie, le présent pour avenir, l'extase de s'arracher à soi-même, le grand jeu ; avec Albert, l'avenir depuis le passé, le respect de ce que l'on veut être, les petits points. Lorsque Arthur essaye ses pensées brouillonnes sur Albert (provoquant la brouille) et tente de trouver un compromis lorsque c'est précisément ce que ne lui autorise pas l'attitude de Marie-Julie (elle lui a passé le mètre autour du cou), sa décision est en réalité déjà prise et ses révoltes velléitaires traduisent la douleur d'un arrachement qui s'est déjà produit. Arthur a choisi : celui qui l'avait choisi (pour reprendre l'atelier) - contre celle qui s'était laissée choisir sans l'élection réciproque qui garantit la relation. C'est un conte très moral, comme aurait pu l'entendre Rohmer. Pas la raison contre le cœur, non : entre la fille et l'homme, Arthur a choisi l'amour – d'où l'inversion des codes lorsque son affection pour le vieil homme le conduit à l'exagération d'un baise-main puis d'un bouquet en signe de réconciliation. « Mais ce n'est pas à moi qu'il faut apporter des fleurs, mon p'ti ! », bougonne le tailleur. Cette note finale est une petite merveille ; elle fournit un contrepoint comique qui interdit de prendre toute l'histoire au tragique. L'épisode est clos mais on se le repasserait bien en boucle.
14:10 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, décorticage
09 octobre 2010
Tout est dans la cuillère
[spoiler, surtout dans le dernier paragraphe]
[vu avec Palpatine mardi dernier, mais si j'avais su, c'eût été avec Melendili]
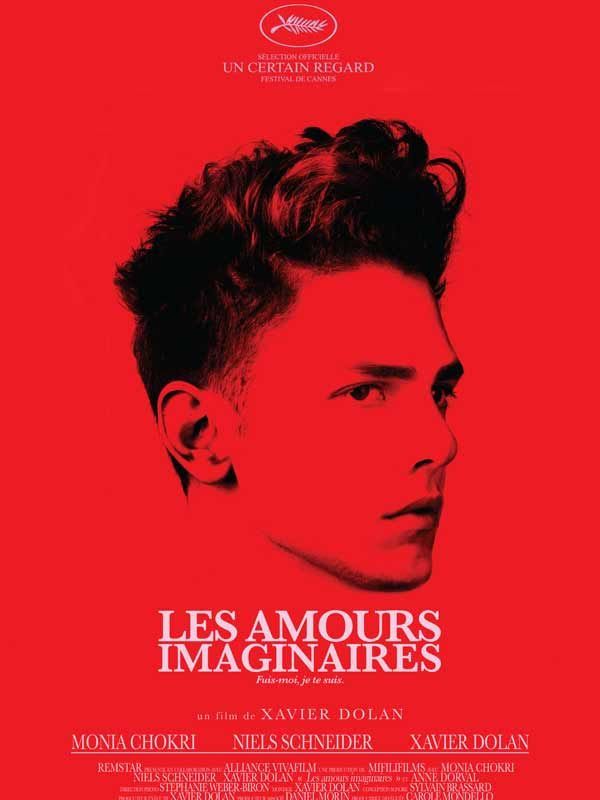
Les amours imaginaires est un film de Xavier Dolan (en fait, il n'a aucun petit côté Rimbaud).
Les amours imaginaires sont d'abord celles de quelques individus sans lien avec l'histoire principale, ni les uns avec les autres. Ces personnages épisodiques (*Kundera power*) n'ont en commun que la désillusion d'amours déçues avant que d'avoir véritablement existé – que ce soit parce que l'un ne se doutait de rien, ou parce que les deux n'aimaient que la liberté permise par l'éloignement (« t'aimes le concept plus que l'autre, c'est con »). De n'être adressées qu'à la caméra, c'est-à-dire au neurone sur-interprétatif de chaque spectateur, leurs confessions deviennent drôles («il était allemand - enfin, il l'est toujours... je crois »), et l'on rit d'autant plus facilement que l'accent canadien (sous-titré français ! - c'est pour le moins idiomatique) permet d'instaurer une distance face à un comportement bien familier. Parce que le film est avant tout la douche froide (répétée) du neurone sur-interprétatif, cette manie d'interpréter tout mouvement comme un geste, tout geste comme un signe, et tout signe comme confirmation de fantasmes échafaudés sans fondements (*Spinoza power*) :
Les amours imaginaires sont celles de Marie (Monia Chokri) et Francis (Xavier Dolan), deux amis qui tombent amoureux de Nicolas (Niels Schneider), jeune éphèbe blond et bouclé qui, comme son ancêtre romain, n'affiche pas d'orientation sexuelle clairement définie. Ainsi que le montrent les images insérées dans le stroboscope d'une soirée arrosée, Marie le rêve statue grecque conduisant son quadrige, et Francis lui a conCoctéau un profil d'un seul trait. En l'absence de tout signe qui vienne infirmer ses fantasmes, chacun cherche à le séduire, et si Marie ne se départit plus de son chignon-banane, rang de perle et trait d'eye-liner une fois que Nicolas a déclaré son admiration pour Audrey Hepburn, Francis lui offre aussitôt une affiche de l'actrice. Les deux amis ne cessent pas de l'être et l'on sent dans une scène filmée au ralenti toutes les contradictions de leur situation : arrivés tout deux au café (ils font la paire pour Nicolas), celui-ci se précipite dans les bras de Marie, et l'on voit le visage envieux de Francis sourire pour son amie, transformant la jalousie en déception douloureuse – et la scène se répète en symétrie inversée lorsque Nicolas salue Francis tout aussi chaleureusement. Tout le film, jusqu'à sa chute finale, fonctionne sur ce principe de double déception.

Les amours imaginaires sont alors les baises (ce sont les termes du générique, où les acteurs sont crédités pour la baise 1, baise 2, baise 3) où l'esprit déçu s'oublie dans le corps et les bras d'inconnus. Ces seules amours qui soient de chaire et de sang sont pourtant filmées de manière irréelles, dans des monochromes qui correspondent aux affiches. Lorsque amour-passion et amour-relation ne concordent pas, difficile de dire lesquelles sont le plus imaginaires, de celles qui n'existent que dans un univers mental qui ne supporte pas la contradiction du monde réel, ou de celles qui ne font l'objet d'aucune représentation mentale et partant ne sont investies d'aucun sens. Pourtant, ces baises monochromes comptent parmi les plus belles scènes, filmées avec pudeur, sensualité et cadrages étonnants où l'on sent la tristesse de l'un aussi bien que le grain de peau de l'autre. Reléguées hors de l'histoire, elles appuient l'intuition qu'a finalement Marie, selon laquelle « tout est dans la cuillère » - qui n'a rien à voir avec mon bon coup de fourchette, mais fait référence à la position dans laquelle les amants se retrouveraient au réveil. Le lyrisme a tôt fait d'être écartée par la coiffeuse qui coupe Marie dans son élan en même temps que ses cheveux (« j'ramasse beaucoup de p'tites cuillères vides ») mais l'image demeure comme illustration de ce qu'est « être ensemble », l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Là où Marie se trompe, c'est lorsqu'elle se dit que ce n'était « même pas la baise », puisque c'est bien cette finalité où est censée se marquer la préférence, qui l'a empêchée d'apprécier les moments passés avec Nicolas (et Francis) où elle n'a vécu que dans sa tête ; ce qui a été vécu est frappé de nullité et, en l'absence de cul, devient cul-cul.

Les amours imaginaires racontent une histoire qui n'en est pas une – ni même deux. Plutôt une variation sur le thème de la désillusion amoureuse. L'ouverture est à ce titre particulièrement bien trouvée, et l'effet en est renforcé par une piqûre de rappel en cours de route. Les confidents aux illusions plus qu'aux cœurs brisés forment ainsi un contrepoint comique à une histoire vécue comme une tragédie par ses personnages (ou serait-ce l'inverse ?) - de risibles amours, imaginaires mais cruels de l'être. Le neurone sur-interprétatif est si redoutable que malgré le titre, la thématique affichée et les doubles déceptions en cascade, la spectateur est encore surpris lorsque Nicolas ne choisit pas l'un ou l'autre (homo ou hétéro) mais ni l'un ni l'autre (ami ou amant), et les deux amis repartent pour la même erreur lorsque Louis Garrel entre en scène. La boucle est bouclée, noire et attirante même. Le triangle va encore sonner faux et j'en ris : j'ai passé tout le film à me dire que Niels Schneider ressemblait à Louis Garrel en plus blond et plus fade (c'est sûrement un pléonasme, ceci dit, parce que je cherche toujours vainement autre chose qui donnerait un jeune éphèbe un peu falot dans un cas et un bouclé délicieusement agaçant dans l'autre), et là, paf ! il apparaît, comme si mon imagination avait influé sur le cours du film qui me surprend alors et trahit mes élucubrations. L'imaginaire, c'est comme le rire, contagieux, et les amours qui le sont, un excellent film pour ceux qui s'en font (des films).
23:30 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : film, cinéma, décorticage, kundera power
17 septembre 2010
Télérama a encore fumé
En voyant dans le métro la publicité pour la série de DVD de rock lancée par Télérama, j'ai immédiatement pensé que les couvertures avaient des allures de paquet de cigarette, peut-être un mix entre Marlboro pour la "mise en page" et Lucky Strike pour les couleurs et les courbes.
Promis, je n'ai rien fumé, pas même du saumon, et je ne bois pas.
Oui, je suis une fille sérieuse - ou ennuyeuse, c'est selon.
21:02 Publié dans D'autres chats à fouetter | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : publicité, décorticage
09 septembre 2010
Poetry

Poetry est un film asiatique (sud-coréen, de Lee Chang-Dong), un film subtil, mais nul besoin d'aimer les fleurs ou de dire des choses bizarres comme l'héroïne pour l'apprécier. Les poèmes qui sont récités au club où Mija (Yoon Jung-hee) se rend ne m'atteignent pas, je reste hermétique au chant du grillon et à la douleur des épines de rose, et cela ne m'empêche nullement d'être émue par cette histoire. Car c'en est véritablement une, et non pas seulement une suite de beaux moments collectionnés ; le film a beau être long (2h19), il n'est jamais lent, et si l'héroïne s'abîme parfois dans la contemplation de quelque élément naturel, le spectateur n'est pas tenu d'en faire autant. Le seul plan véritablement contemplatif, c'est celui du générique, le fleuve Han devant les montages, qui dépose sur la berge le cadavre d'une écolière lorsque les noms ont fini de s'écouler.
La poésie, confie le maître (poète et professeur du cours où Mija s'est inscrite), n'est pas dans la belle apparence ; elle se trouve en chacun de nous - dans le regard et non pas dans l'objet, donc. Elle se trouve même dans la vaisselle sale, ajoute-t-il, me faisant rire de Palpatine tout comme lui a ri de moi lorsque Mija, après avoir vainement observé le fruit rouge et rond conclut qu'une pomme est faite pour être mangée, pas observée. De fait, Poetry n'est pas poétique parce qu'on y récite quelquefois des poèmes, mais parce qu'on y recherche la beauté au-delà de l'esthétique, la beauté de ce qui a un sens malgré la laideur physique ou morale. Il n'est pas étonnant que Mija ait tant de difficulté à écrire de la poésie et que le spectateur la perçoive bien avant qu'elle ne soit capable de l'exprimer dans un poème qui achève le film ; le montage élabore petit à petit un sens que l'héroïne ne peut reconstruire que dans l'après-coup.
Pour elle, il y a son petit-fils indifférent, ses cours de poésie, ses heures de ménages et le mystère de l'écolière qui s'est suicidée et dont le corps a été amené à l’hôpital au moment où elle en ressortait après qu'on lui ait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Pour le spectateur, tout cela est déjà intriqué, sur le point d'être relié et rendu sensible : [*spoiler mode on*] si elle finit par accepter la demande du vieil homme dont elle s'occupe, de lui permettre de se sentir une dernière fois un homme, alors qu'elle avait fui la fois précédente, lorsqu'elle avait découvert la nature des « vitamines » qu'il lui avait intimé de lui donner, c'est qu'elle entend redonner un sens aux gestes que la bande de gamins dont son petit-fils fait partie ont portés sur le corps de l'écolière suicidée, transformer des mouvement en un geste envers un homme certes vieil, mais humain néanmoins, comme ne permettent pas de l'oublier les yeux d'amour ((é)perdu(s) dans le sens élargi de reconnaissance) qu'il pose alors sur Mija. La scène est magnifiquement filmée, ne montre que ce qui est nécessaire, sans pour autant que l'on ait l'impression que la cadrage s'arrête toujours de justesse à 'ce qu'il faut cacher'. La lecture d'Ariana me revenait à l'esprit, rendait le moment évident sans l'évider en rien. Les belles analyses savent se faire oublier après avoir rendu l’œuvre qu'elles commentent plus présente parce que plus lisible. C'est à ce passage-là que je m'étais dit qu'il fallait que je vois ce film, et pourtant, dans la salle de cinéma, je ne l'attendais plus, les idées ne me sont revenues qu'avec les images.
Cette scène est peut-être un des exemples le plus frappant des juxtapositions sensées quoiqu'à peine senties que dispose le film. L'ordre est parfait, instaure et tient un incroyable équilibre : lorsque les pères des gamins criminels s'entendent pour acheter le silence de la mère de l'écolière, Mija est là, quoiqu'elle ne se soucie pas de son petit-fils au sens de ces hommes ; elle n'en cherche pas moins à rassembler la somme convenue, qu'elle demande au vieil homme sans que cela annule pour autant le don qu'elle lui a fait (et même s'il qualifie cela de chantage, il sait qu'il lui est redevable d'un peu d'humanité, et tout avare qu'il est, lui donne la somme requise). Mija sait néanmoins que les choses ne peuvent demeurer en l'état, tues et absurdes, mais à aucun moment il ne s'agit non plus de justice au sens où le petit-fils devrait payer – c'est réparer qu'il lui faut, après un acte insensé- et c'est à la mère de l'enfant qu'elle demande de l'emporter, avant que n'arrive la police. Cette arrestation sans menotte ni arrêt dans le jeu est un autre très beau moment : alors que le petit-fils fait l'effort de jouer au badminton pour permettre à sa grand-mère de faire un peu d'exercice comme le lui a recommandé le médecin, arrive le policier qu'elle avait rencontré au club de poésie et dont elle n'avait pas apprécié les blagues salaces. Il vaut mieux qu'il n'en a l'air, lui avait soufflé sa voisine, au sens de la beauté de laquelle Mija a d'emblée été sensible. Effectivement, le policier prend le temps d'admirer leur bel échange, et lorsque son collègue fait monter le petit-fils en voiture, il prend la place de ce dernier et, en poursuivant le jeu, donne la réplique à la grand-mère. Une nouvelle fois, la véritable poésie n'est pas en vers - ou alors envers la sensibilité de l'autre. Cela a tiré une phrase d'Epictète de ma mémoire approximative, comme quoi l'essentiel de la vie n'était pas le résultat du jeu mais de jouer selon les règles ; un beau jeu plutôt qu'une belle victoire. Aussi simple que l'élégance dont Mija ne se départit pas, qu'elle soit ou non de circonstance.
Le poème qu'écrit finalement Mija ne vaut pas par sa qualité littéraire mais par sa seule existence : elle a su sentir, c'est-à-dire rendre sensé le sensible – ou sensible l'insoutenable inintelligible. Ce n'est pas un hasard si c'est à chacune de ses approches de la collégienne (lorsqu'elle se rend à la messe dite pour elle, au laboratoire où six mois durant elle a été violée, sur le pont d'où elle s'est jetée, ou chez sa mère, dont la maladie lui a fait oublier l'identité et tenue à distance de toute compromission ou condoléances blessantes et inutiles) qu'elle note des bribes de beauté dans son carnet (« Le chant des oiseaux : que chantent-ils ? » - la forme sans encore le sens) : elle cherche la beauté là où le sens a douloureusement disparu. Tant et si bien qu'elle ne transforme pas l'horreur insensée en poésie (aucune alchimie ne ressuscitera la collégienne), elle n'a pas cette indécence ; mais, sans s'être séparée de tout ressentiment, peut-on supposer, elle donne seulement à sentir la vie de la jeune fille, ce qu'elle a ressenti à sa mort, d'où les dernières images du film et de la jeune fille qui se tourne dos au fleuve et face à la caméra, souriante, avant que le film ne se boucle dans les eaux du fleuve. Mija, absente lorsque le maître lit son poème qui fait dériver les images jusqu'à celle de la jeune fille, s'est déjà discrètement effacée, comme sa mémoire est appelée à l'être.

11:32 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : film, cinéma, décorticage