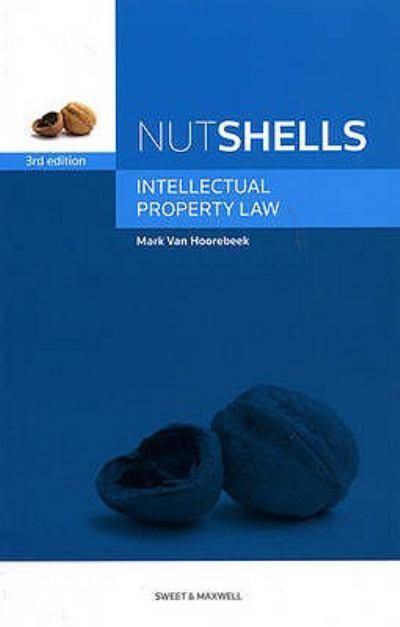08 août 2013
Bits of London
À la table du petit déjeuner, une petite fille blond pâle, pas bien réveillée, porte un maillot de quidditch Gryffondor qui la fait ressembler à Luna. Lorsque le père, que j’avais pris pour la mère à cause de sa queue de cheval, se lève pour aller se ravitailler au buffet, il découvre un T-shirt Star Trek – famille de gentils freaks.
Sur Leicester Square, enfin sorti des travaux à l’exception de la statue centrale, un frère et une sœur jouent sur des smartphone : le frère en bleu sur un smartphone rose ; la sœur en rose sur un smartphone bleu.
Le tailleur de Palpatine, logé dans une petite maison anonyme aux fenêtres-guillotines, nous demande si l’on souhaite boire quelque chose et a l’air un peu étonné de notre réponse : il nous ramène de l’eau dans de grands verres à bière.
Je prends part au brainstorming sur les tissus à utiliser mais je crois que c’est uniquement pour pouvoir jouer avec les nuanciers et feuilleter une à une les étoffes aux couleurs, reflets et motifs délirants. Le tissu noir à têtes de mort vertes a déjà été utilisé comme doublure – j’espère apercevoir lors des essayages les ronds orangés et moirés so soixante-dix.
- Il n’y a plus qu’à traverser le parc.
- Non mais ce n’est pas le bon parc.
- …
- On devrait faire des itinéraires comme ça, pour voir si les gens arrivent à destination, comme des recettes : prenez un parc, traversez-le…
C’est au Royal Albert Hall qu’on aurait dû donner le nom du Coliseum : l’impression que l’on a, perché en haut de cette gigantesque arène, est exactement celui que j’imagine pour le Colisée de Rome. Je n’ai pas été très très attentive pendant le concert, trop occupée à observer les gens debout, en tailleur ou allongés au parterre, compter les tuyaux de l’orgue et débusquer les buffets cachés à l’arrière de certaines loges.
L’averse orageuse londonienne typique met en relief le dallage très inégal des trottoirs : d’immenses flaques se forment, où l’on plonge la totalité du pied si on n’y prend garde – l’équivalent du bain de pieds désinfectant à l’entrée de la piscine, la propreté en moins. Rapidement, les parapluies ne sont plus suffisants et les piétons se transforment en grenouilles sauteuses.
Au moment où, errant dans Camden market depuis une vingtaine de minutes et désespérant de trouver le glacier indiqué par Hugo, on envisageait de se rabattre sur le carrot cake, l’échoppe des Chin Chin Laboratorists est apparue devant nous. Des nuages de fumée coulent des saladiers où tournent des batteurs électriques pour refroidir les préparations liquides à l’azote. Des blouses blanches aux lunettes de chimiste s’affairent tandis qu’on lit la description de produits vantés comme hyper naturels – un contraste qui résume bien le paradoxe du bio, plus médical que naturel. L’apricot and jasmine ayant été remplacé par le rose and lychee, cela sera chocolat, avec des morceaux de chocolat blanc grillé. Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant de la glace à l’azote ou des miettes sans la moindre trace blanche qui ont le goût de chocolat blanc. À moins que ce ne soient les yeux du vendeur très mignon, qu'avait oublié de mentionner Hugo : je fonds avant la glace.
Un, deux, trois, beaucoup de saumons à contre-courant alors que l’on rentre à l’hôtel. Quand une foule de saumons remonte la rivière, c’est qu’ils sont la rivière – proverbe du soir londonien. On remonte à la source : la mosquée déverse des flots d’hommes barbus en tuniques blanches et de femmes Casper, qui irriguent les trottoirs et se dispersent dans les rues, les bus, les canaux qui mènent à Little Venice et ailleurs.
Des triangles en folie : toastés, à la marmelade d’orange, trempés dans le thé au petit-déjeuner ; nature ou complets, brie-cranberries-raisin, fromage-chutney de carottes, œuf-mayo-cresson ou custard ham le reste de la journée.
Les écureuils aiment les princes. Surtout lorsqu’ils sont à croquer. J’en lance un bout à un écureuil roux répondant à tous les critères du cute. Il apprécie tellement que, lorsque je m’apprête à remettre le paquet dans mon sac, il laisse tomber le petit morceau qui lui glissait entre les pattes et, me confondant avec un arbre, s’élance directement à la source des gâteaux. Surprise qu’il me grimpe dessus, je pousse un cri strident. Je vois en même temps les touristes alentours se retourner, les plus proches se mettre à rire et l’écureuil redescendre pour s’emparer des gâteaux qui, dans mon agitation, sont tombés du paquet. Encore heureux, la bestiole n’aurait pas hésité à me griffer tout le corps et à mordre pour que je le lâche ; je me voyais déjà dans un remake des oiseaux d’Hitchcock. La jambe toute griffée, jusqu’au sang sur la cuisse – je manque un peu d’écorce, voyez-vous – je déclare l’embargo de nourriture pour les écureuils du monde entier, vérifie mentalement que je suis bien vaccinée contre le tétanos et nomme l’écureuil à la place du pigeon dans le rôle du rat volant tandis que Palpatine me rappelle la cage spécial visage de 1984. J’en ai recroisé ensuite, qui m’ont dévisagée avec un air mauvais. Tout ça parce qu’en face d’une petite souris, ils pouvent jouer aux gros écureuils. Saletés. Beware of the squirrel. Don’t feed the squirrel or the squirrel will feed off you.
Quatre petits pots sur la table : strawberry, raspberry, blackcurrant et l'orange marmelade que l'on a seul vidé méticuleusement, chaque matin.
Premier étage, premier rang, j’ai pris place à bord du magicobus : cerné des deux côtés par deux gros bus londoniens, il s’amincit et se faufile sans encombre.
Sur les dalles, les pavés, les trottoirs, le bord de la chaussée, les allées, les gravillons, la terre battue, la pelouse, on a marché, marché... Le soir, quand les tendons à l'arrière de mes genoux sont complètement crispés et que je teste différentes manières de claudiquer, je demande à mon compteur subjectif le nombre approximatif de kilomètres parcourus : huit, dix, douze, treize, quinze, dix-huit... les kilomètres s'additionnent au fur et à mesure que mon GPS préféré retrace mentalement la carte de nos déambulations. Le tout en sandales, garanties ampoules proof.
Les vitrines qui font penser à... JoPrincesse : des Monsieur et Madame partout, en peluches et en mugs, mais pas de Princesse – pour cause de concurrence déloyale à la monarchie, sûrement ; Hugo : une lampe lapin spottée près de Carnaby street ; Palpatine : des cufflings en forme de pingouins (je préfère les cufflings aux boutons de manchette, qui m'inspirent le même sérieux que les rouflaquettes).
Snog, recommandé par Pink Lady, propose de composer sa coupe sur mesure en choisissant un parfum de yogurt glacé et un ou plusieurs topping. Moi qui ai toujours envie de dépareiller les coupes à la carte, d'enlever le coulis de ceci, de rajouter de la chantilly à cela et de tester de nouvelles combinaisons gustatives, c'est tout à fait à mon goût. Le concept embête Palpatine, qui n'a pas envie de se casser la tête pour « des bêtises ». Combiner les saveurs et les textures ne me semble pourtant pas très différent des associations de tissus et couleurs qu'il arrange avec goût dans son habillement.
Pourquoi les businessmen britanniques font-ils paraître les français avachis ? Palpatine m'assure que les costumes, trop longs par chez nous, sont ajustés au millimètre outre-Manche : le pantalon casse sur le soulier au lieu de plisser, les manches de la veste laissent apercevoir celles de la chemise et les entournures rendent impossible de voûter les épaules, contraignant à se tenir extrêmement droit. Ces précisions vestimentaires me permettent d'entrevoir la véritable réponse à ma question, une évidence : la veste ne cache pas les fesses. Londres est pleine de petits culs élégants.
Quelle heure est-il ? 11h50, l'heure d'aller se laver les dents. Palpatine retombe dans un demi-sommeil. Un quart d'heure plus tard, il me repose la question, me souhaite un joyeux n'anniversaire et se rendort.
Je n'ai pas été chez Richoux, je n'ai pas mangé de scone, je n'ai pas été dans la librairie à côté de Fortnum & Mason, je n'ai pas traîné les pieds à Savile Row, Palpatine n'a pratiquement pas râlé contre le tube et je suis presque contente que le HMV de Piccadilly ait disparu : je n'ai pas envie que Londres devienne un pèlerinage.
Vingt-cinq ans aura été un anniversaire sans bougie, une belle journée tranquille, que l'on n'essaye pas à tout prix de transformer en fête – plutôt un acquiescement au temps qui passe. Il paraît que la perception qu'on en a s'accélère avec l'âge : ne pas s'en effrayer, ne pas non plus fantasmer une facilité future, prendre sa respiration et avancer – on ne mûrit qu'à son temps, toujours un peu trop lentement. Le temps avance plus vite que nous : on a cherché en vain dans les livrets de 2012 et 2011 le portrait devant lequel on était tombé en admiration au concours annuel de la National Portrait Gallery ; cela fait trois ans qu'il trône dans le salon de Palpatine, que je squatte de plus en plus régulièrement. iDeath, qu'il s'appelle. D'une beauté à couper le souffle.
23:31 Publié dans Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : londres, voyage
08 octobre 2012
Uncommun law
« Je veux juste passer à la librairie juridique. » Voilà une annonce qui me remplis généralement d'effroi lorsque je suis à Paris avec Palpatine. La librairie juridique est la seule librairie – avec la librairie religieuse et/ou de sciences occultes – où je n'ai aucun plaisir à fouiner et où je dois faire appel à ma formation d'éditrice pour y trouver un quelconque intérêt (les éditions juridiques sont parmi les plus soignées) et faire passer le temps.
À Londres, on est accueilli par un canard en plastique en tenue de juge, presse-papier factice pour des pavés de 400 pages au bas mot. Ses collègues se trouvent sur le comptoir de la caisse, en panoplie d'enquêteur et de policier – élémentaire, mon cher Donald duck ! Comme je reconnais facilement mes congénères, je débusque une toute petite souris en pâte Fimo – juge, elle aussi, avec une perruque à croquer.
Une des trois petites sur la droite. Ultra-choupie. Et ce n'est pas la seule.
Dans la même vitrine, moult petits objets, et notamment une série de boutons de manchettes, dont celui-ci :
Quand l'esprit british croise l'humour d'avocat, cela donne aussi des bloc-notes second degré :
Crise de fou rire : cela va tellement bien à Palpatine.
Rire jaune : cela va tellement bien à A.
Non seulement les avocats britanniques semblent rire volontiers, mais ils rient intelligemment : à l'entrée de la librairie se trouve une étagère de classiques littéraires, qui suggère qu'on ne juge bien les hommes qu'en ayant fait ses humanités. J'aime cette vision décloisonnée des choses (quand cela est plus disciplinaire chez nous, il me semble), qui sous-tend une conception des études littéraires comme étude des hommes à travers les livres et non des livres à travers leur seule technique – même si le style d'écriture importe, en témoigne un ouvrage tel que l'Oxford Guide to Plain English. Apprendre à éviter la langue de bois et à s'exprimer le plus clairement possible, voilà qui n'est pas du luxe et que je n'ai pourtant qu'entrevu rapidement lors de mon premier master 2. Placer ses jambes lorsqu'on prend la parole, préférer le verbe au nom ou encore articuler en ouvrant la mâchoire, de façon musculaire et non pas seulement phonétique... j'ai davantage progressé en un semestre que lors des deux années de fac. Ce cours d' « anglais professionnel » mériterait d'être donné indépendamment du cours de langues dans lequel il s'inscrivait.
Et pour terminer cette visite surprenante, de l'humour éditorial avec une collection d'ouvrages de révisions baptisée Nutshells (tout est là, in a nutshell – et en schéma, se hâtera de préciser Palpatine).
London. Love that city.
19:38 Publié dans D'autres chats à fouetter, Souris des villes, souris des champs | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : londres, librairie
02 mai 2012
Alice's adventures in wonderland: well done!
Suivant le conseil de Pink Lady, qu'il y aurait sûrement des places de dernières minutes, ma mère et moi avons dégoté deux places, l'une à l'amphithéâtre, l'autre debout au premier balcon, pour assister de nouveau à un ballet de « Welldone », en franglais dans le texte. On n'aurait su mieux mal prononcer : la création de Wheeldone est vraiment une réussite. Ce chorégraphe éclectique, qui passe de l'abstraction la plus balanchinienne au ballet narratif le plus traditionnel qui soit, a eu l'intelligence et l'humilité de reconnaître son point faible pour s'entourer en conséquence. Résultat, sa collaboration avec un dramaturge fait d'Alice's adventures in wonderland un spectacle total, qui n'oublie ni ne se limite à la danse.
Photo de Johann Persson
Après avoir vu le décor projeté s'agrandir pour suggérer qu'Alice rapetisse, puis jouer de la perspective pour la faire paraître immense dans un cube savamment déformé, avant qu'elle ne se lance à la poursuite d'une miniature porte téléguidée, on ne sait plus à quoi s'attendre, et on attend, tranquillement émerveillé, de voir quelle invention on nous aura concocté. Les décors ne participent pas peu à la chose : moi aussi, je veux faire du trampoline sur un scone géant, m'assoir dans une tasse bien tassée (déjà fait à Eurodisney, c'est vrai) et faire des claquettes sur une table où chaque tasse devient une ampoule pour créer une rampe à cette scène improvisée. Après, il est vrai que je me dispenserais bien de me faire étrangler par une guirlande de saucisse, mais je prêterais volontiers patte forte à la chenille aux multiples pointes pailletées, véritable passage en revue.
On ne s'attendait pas à cette débauche d'imagination lorsque le rideau s'est ouvert sur une garden party very Onéguine-like, où parmi une assemblée joueuse et nombreuse, Lauren Cuthbertson fricote avec un jardinier tout ce qu'il y a de plus propre à vous faire rosir (Federico Bonelli). Il s'agit de notre héroïne, à l'évidence, même si sa sœur habillée en bleu-Alice et son serre-tête de Blanche-Neige portent d'abord à confusion. Mais c'est la première et la dernière chose qui m'a gênée, si l'on peut même parler de gêne. Dès qu'elle se lance à la suite du lapin en pleine métamorphose (la queue qui sort soudain du pantalon est un premier éclat de rire), on tombe en plein délire – enfin, sa marionnette, agitée par un tourbillon de lettres nous entraînant en plein cœur de l'histoire. Je dois dire que cela a titillé ma fibre typographique, comme, un peu plus tard, la page projetée au sol, terreau propice à une valse des fleurs.
Photo de Johann Persson
Au fil des rencontres que le rêve, avec sa puissance de distorsion, sait rendre plus intéressantes que l'original dont elles sont inspirées, Alice imite tour à tour le lapin qui se gratte le mollet avec son autre pied, le chapelier aux claquettes folles, ou la chenille aux ondulations orientales. Tandis que chaque personnage a un trait, un pas, qui le caractérise, Alice absorbe toutes les influences extérieures. En cela, c'est bien une enfant qui reproduit, non parfois sans maladresse, ce qu'elle voit pour ensuite en faire son miel. Sa personnalité se compose comme le chat du Cheshire, petit à petit, par intermittence, prompte à s'éclipser. La manipulation, qui d'une patte, qui de la tête ou de la queue, rend chacune de ses apparitions aussi spectaculaire qu'un dragon chinois.
Photo de Denis Sum
C'est ainsi, chemin faisant et mine de rien, qu'Alice laisse à la reine sa nature capricieuse. Elle l'a laissée à la porte de ce nouveau monde lorsque, sautant en retirés pour atteindre la poignée trop haut placée, elle a trépigné par ces mêmes retirés devenus piétinements rageurs par la seule force du changement d'accent, d'en l'air à en bas. La reine, elle, n'a pas grandi ; c'est plutôt ses enfantillages qu'elle a laissé croître jusqu'à la cruauté. Du coup, le troisième acte qui se déroule en son royaume est une véritable apothéose. L'extravagance règne sans partage : les fleurs changent de couleur toutes seules, au grand désespoir des jardiniers ; les conifères, qui viendront saluer d'une inclinaison de frondaison, se meuvent sur roulettes, de même que la reine encastrée dans une robe-coeur-carosse géante tractée par ses serviteurs ; la partie de croquet est jouée par de petits garçons hérissons (la dame à côté de moi, très droite, très fière, m'apprend que le hérisson, là, c'est son élève) et des danseuses flamands roses plongées en avant sur une jambe (exactement comme dans Polyphonia), le bras devenu cou et la main, bec ; quant aux cartes, le plateau des tutus se renverse en avant pour se faire carreau, pique, trèfle ou coeur, et les valets craignent la visite de la reine. Cela donne lieu, lorsque la reine ouvre sa robe et emprunte l'escalier qui y était caché, à un pas de quatre d'anthologie où chaque valet est à son tour le pouilleux désigné pour la porter : elle refuse l'appui de sa main au premier, développe un index trancheur en même temps que sa jambe avec le deuxième, et trop imposante pour le troisième, finit par terre comme la danseuse dans la parodie du grand pas d'Auber (on se situe dans la même veine).
Photo d'Alice Pennefather
Un flamand rose sur un mur qui picote du pain dur...
Photo de Bill Cooper
Laura Morera, comme l'avait prédit la guichetière, est extraordinaire. Tout à fait monstrueuse. Sa façon de pencher la tête en avant rappelle à tout instant sa marotte sanguinaire, mieux encore que d'incessants "Qu'on lui coupe la tête !", et crée un contraste détonant entre cette inclisaison sénile et ses arbitraires enfantillages. Cette gamine gâteuse poursuit en effet les têtes avec la même avidité que les petits gâteaux rouge pailleté que dégustrerait une vieille dame à l'heure du thé. Elle peut bien pleurer au procès sommaire qu'elle tient contre le prétendant d'Alice, tous les témoins entassés dans des box en cartes à jouer, elle n'en revient pas moins toujours à l'attaque, tête penchée : une véritable désaxée. Tout comme la hache tombée en trois temps entre le deuxième et troisième acte : 1, elle se détache du ciel ; 2, le regard rebondit sur la goutte de sang qui perle et s'avère être un coeur ; 3, sur la lame s'affiche un "Interval" qui coupe court à l'action, mais pas au rire.
Après une telle animation, on traine des pieds sur le chemin du retour, redoutant l'inertie de la garden party. Mais que nenni, c'est à l'époque d'aujourd'hui que nous revenons, Alice et son prétendant devenu boyfriend en baskets se bécottant comme des amoureux sur un banc public, bientôt remplacés par l'ex lapin très british, bras de chemises retroussés, sûrement un professeur de littérature qui ouvre devant nous le roman de Lewis Carrol. Dernier éclat de rire, intérieur cette fois, parce que l'image de From-the-bridge a surgi comme un pop-up. Loin de moi l'idée de dire que mon prof d'anglais de prépa ressemble à un lapin, mais par cette même évidence saugrenue qui donne des yeux de poisson à Goerne, l'ex-lapin est devenu un professeur très grand, très fin, aux manches retroussées. Jusqu'au bout, le nonsense aura été parfaitement restitué, bien plus puissant que l'extravagance du conte. De fait, je me suis vraiment amusée de ce comique anglais, présent jusque dans la musique pétillante de Joby Talbot, sans laquelle le spectacle ne serait pas ce qu'il est. Cette partition originale (dans tous les sens du terme) nous change des créations sur fond musical insipide (La Petite Danseuse de Degas, 0 / Alice's adventures in Wonderland, 1).
22:51 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : danse, ballet, londres
29 avril 2012
Triple bill at Covent Garden
Samedi 14 avril
Photos plus tard, lorsque mon PC aura réappris le clic droit.
Dans Polyphonia, Christopher Wheeldon traque l'harmonie sur la musique dissonante de Ligeti : les danseurs, seuls ou en couples, sont autant de voix qui se superposent, se répondent ou s'ignorent. À tout instant le chaos devient canon, bientôt synchronisé à l'unisson, aussitôt décalé en cascade. Les ensembles désassemblés laissent parfois la place à des pas de deux plus troublants, où les dissonances menacent de se muer en discordances.
Les mouvements sont au diapason de la musique : aussi inattendus que la note qui suit – ou pas. S'il y avait plus de déhanchés, on jurerait voir du Balanchine. Ce sont les mêmes lignes, brisées et remodelées, et les mêmes justaucorps, ceinturés à la taille, à ceci près qu'ils ont leur propre tempérament : violet comme les Sweet Violets de Liam Scarlett – au point que j'ai cru à une inversion des deux titres. Mais Christopher Wheeldon possède un vocabulaire qui lui est propre, avec des portés où la danseuse n'est pas déployée par son partenaire, comme c'est souvent le cas d'habitude, dans les pas de deux amoureux où la passion porte toujours plus haut, plus loin, plus fort, au risque de devenir sportive ; au contraire, la danseuse est repliée sur sa jambe de terre loin devant elle, et son partenaire maintient ses hanches-fermoir comme s'il était garant d'un secret. Et si l'on s'écarte de la ligne, ce n'est pas au niveau des hanches, comme chez Balanchine, mais des genoux, seuls à pouvoir alors briser l'immobilité.
Enfin, parmi toutes les notes éparpillée, n'oublions pas la note d'humour, lorsque les danseuses plongent en avant, mains par terre, jambe repliée en parallèle montée derrière elle, ou lorsque deux danseurs aux gestes suspendus attendent un improbable accord pour prendre la pose finale. Le ballet en devient moins grinçant qu'agaçant un spectateur qui reste un peu sur sa faim alors qu'il n'en a pas perdu une miette.
À voir, une interview du chorégraphe, entrecoupée d'extraits (à 1'26).
* * *
Sweet violets n'a de commun avec Polyphonia que la couleur. Et un chorégraphe jeune. Très jeune, même, en ce qui concerne Liam Scarlett, qu'on dit prometteur parce qu'il est encore vert. J'avais déjà vu Asphodel Meadows, plein de beaux moments, mais plein jusqu'à la saturation, comme si le chorégraphe avait voulu en une pièce montrer toute l'étendue de sa créativité. Si la danse est plus aérée dans ce nouveau ballet, narratif, le foisonnement s'est retrouvé dans l'histoire, qui déborde d'échos n'occasionnant que confusion.
Au cœur de l'intrigue, une prostituée se fait assassiner. Peut-être par un inconnu, peut-être par Jack l'éventreur, peut-être par l'ami de Walter Sickert, un peintre fasciné par ce meurtre au point de le mettre en scène avec le danseur-assassin de la scène précédente, et de finir lui-même en meurtrier. A moins que la silhouette noire qui rôde soit bien Jack l'éventreur, et non la mort personnifiée. Toujours est-il qu'une deuxième prostituée se fait zigouiller. Ou bien un modèle du peintre. Ou une danseuse, tout bien pensé, vu que nos assassins potentiels vont puiser dans ce vivier de gambettes et de gorges bien fraîches – l'épisode n'est pas d'un intérêt exceptionnel, le public n'étant ni celui de la salle ni celui de la scène, mais la scénographie est extrêmement ingénieuse, avec sa guirlande lumineuse au sol pour symboliser la rampe (pour une fois le théâtre dans le théâtre n'échappe pas aux règles de la perspective). On n'a d'ailleurs pas lésiné, d'une manière générale, sur les costumes et les décors.
On arrive ainsi au paradoxe d'une danse très expressive (des corps, de leurs désirs, de leurs instincts) qui remonte des sensations jusqu'aux sentiments, mais ne parvient pas à raconter une histoire. En passant de l'abstrait au narratif, Liam Scarlett a épuré sa danse ; reste à se départir de l'anecdote... ou à embaucher un librettiste. Les scènes autour du lit pourraient ainsi s'émanciper, sorte de Rendez-vous inversé entre le jeune hommes et la mort.
* * *
Carbone life est aussi ambivalent que son composant : diamant brut ou graphite appelant la gomme. Il y a des moments totalement jouissifs, où l'on ferait bien corps avec le ballet, à l'enthousiasme soldatesque, et il y a des moments où ce ne sont plus les spectateurs mais les danseurs qui s'abandonnent – au plus grand nawak. Je n'aurais pas vu grand inconvénient à fermer les yeux dans, voire sur, ces moments, si je ne devais déjà me boucher les oreilles à cause des chanteurs, enfin, des gueuleurs présents sur scène. Faut-il nécessairement faire mal aux tympans pour être rock'n'roll ? Une chose est sûre, ceux-là, je ne les inviterais pas dans mon Appartement. Ils m'ont gâché une pièce par ailleurs très travaillée au niveau de la scénographie et des lumières : des formes géométriques qui répondent aux costumes improbables des danseurs. Je reste perplexe : serai-je toujours déçue par Wayne McGregor parce qu'il est le chorégraphe d'un Genus où serait passé tout son génie ?
22:05 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : danse, ballet, londres