13 septembre 2015
Le Tout Nouveau Testament athée
En voyant la bande-annonce du Tout Nouveau Testament, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille. J'imaginais que cette parodie biblique serait quelque chose comme une version comique des Intermittences de la mort. Cela commence fort, avec en prologue l'Ancien Testament revu et corrigé sauce Arte : après des girafes de synthèse, c'est un homme nu qui déambule dans les rues vides et pluvieuses du Bruxelles d'aujourd'hui, essaye de se débarrasser du rectangle noir de la censure qui lui colle au cul, et rencontre Ève, nue dans une cantine vide, un badge à son nom collé sur le sein. Avance rapide sur la reproduction des générations : nous voilà aujourd'hui, dans l'appartement de Dieu, un beauf exécrable qui n'arrête pas de faire des crasses à ses créations et de gueuler contre sa gamine, laquelle décide de suivre l'exemple de son frangin JC et se tire pour aller rassembler sa team d'apôtres (JC lui conseille d'en prendre 6, comme ça, avec les 12 à lui, ça fait 18, comme une équipe de baseball – sport qu'adore leur mère et que déteste leur père).
À partir de là, le film se déroule par chapitre, un par apôtre, six séquences où chaque élu-au-hasard raconte son histoire à la gamine qui écoute et épilogue en leur dévoilant quelle est leur « petite musique1 ». Le ton est donné : Le Tout Nouveau Testament, c'est la rencontre de Céline et d'Amélie Poulain. Le rouge et vert, qui auraient révélé le fabuleux destin cliché de l'humanité, ont tourné : le bain du Tout Nouveau Testament ressemble à l'eau qui flotte dans la poêle de Palpatine2 quand l'évier déborde de la vaisselle de toute la semaine. De loin, l'accumulation est comique, mais quand on s'approche, cela se met à puer. Des relents de déception, de ressentiment, d'aigreur. Envers les cons, les beaufs et les simples d'esprit, envers la société toute entière, envers l'homme et envers Dieu, envers et contre tous. L'humour potache, relevé avec beaucoup de légèreté par la culture que suppose la parodie, découvre un arrière-goût de satire – on ne blasphème plus de gaité de cœur. Ma religion, c'est du poulet : sauce aigre-douce. On ne sait pas si la douceur est là pour rajouter quelques grammes de tendresse (le visage tout rond de la fille de Dieu, la rencontre pleine de fleurs jaunes entre la belle apôtre à qui il manque un bras et son condisciple assassin...) dans un monde de brutes (où les SDF se font tabasser) ou bien si l'ironie cinglante doit sauver l'amour de la niaiserie.
Le film se finit sur une pirouette divine : ceux dont l'heure était venue sont épargnés, et les compteurs du temps annoncé jusqu'au décès sont supprimés. On a à peine le temps de savourer ce petit miracle que la femme de Dieu, qui n'est que paix et tricot, se met à refaire la déco de la création et tapisse le ciel avec un motif à grosses fleurs soixante-dizard. Le kitsch de ce papier-peint windosien est raillé avec une virulence qui trahit un certain malaise : en le réduisant à sa dimension esthétique, on veut méconnaître que le kitsch est consubstantiel à l'homme, lequel se sait mortel et fait tout pour l'oublier. Y compris se laisser aller au bon sentiment dans un film déjanté à la Arte. Et railler ce laisser aller. Peut-être que, dans cette comédie aigre-douce, c'est notre condition que nous ne parvenons pas à digérer. En tant qu'athée, on veut avoir foi en l'homme, mais ce succédané d'absolu donne envie de crier je t'aime je te hais à ce Dieu qu'on a tué. T'aurais quand même pu nous faire à ton image, Ducon. Immortels. On se serait marré, au lieu de rire jaune.
1 Petite musique baroque : à la fin de la séance, j'ai entendu un spectateur regretter qu'il n'y ait pas d'autres musiques, « du jazz par exemple ». Fear.
2 Toute coïncidence avec des personnes, réelle ou fictives, est fortuite.
21:36 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, le tout nouveau testament
Sketchy, Quiet, Dull, (hopefully not) Backward
Je sors d'une séance de travail publique à Bastille où Benjamin Millepied, pas avare de son temps ni de sa personne, a fait répéter un extrait de sa nouvelle création Clear, Loud, Bright, Forward, après avoir parlé de ses intentions pour le ballet. Benjamin Millepied devrait faire un bon manager : il a le désir d'accompagner les danseurs dans leur carrière, de ne pas briser leur élan en les faisant poireauter trop longtemps et de faire ressortir ce qu'il y a d'unique chez chacun d'eux. Il est attentif à leur santé, veille à ce que leur entraînement soit régulier (ne pas passer trois mois pieds nus avant de remettre les pointes). Pendant la séance de travail, il ajourne la reprise d'un passage qui ne passe pas, car c'est toujours le même muscle qui est sollicité et il ne veut pas leur faire risquer la blessure, surtout en cette période de reprise où le corps n'est pas aussi réactif que le restant de l'année. Benjamin Millepied est également conscient des réalités économiques : à la question de savoir s'il veut proposer une nouvelle version des grands classiques, il répond que, dans l'absolu, il aimerait, mais que cela coûte une fortune et que dans l'immédiat, il préfère « mettre des sous » dans des créations d'aujourd'hui. Il a également une vision très lucide des forces et des faiblesses du ballet de l'Opéra, de son répertoire (non, tous les ballets de Noureev ne se valent pas ; sa version n'est pas toujours la meilleure) et de ce que chaque école peut apporter (clairement, pour faire travailler le Lac, c'est en Russie qu'il faut aller voir). Et s'il encense la culture et la curiosité de ses interprètes, il déplore aussi le manque d'éducation à la chorégraphie, notamment dans le domaine musical. Petipa et compagnie avaient des connaissances musicales très poussées ; Balanchine était capable d'écrire des réductions pour pianos à partir de partitions complexes ; et aujourd'hui, eh bien, nous avons Millepied.
Son idée d'ouvrir une académie de chorégraphie pour retrouver le savoir-faire des maîtres de ballets d'autrefois est une excellente idée : n'en déplaise à notre tendance élitiste (et paresseuse) à considérer le talent comme inné, beaucoup de choses sont à acquérir. Que l'on pense par exemple, dans le domaine littéraire, aux cours de creative writing : ils ont fait des Anglo-Saxons les maîtres du storytelling et, snobés, peinent à s'implanter par chez nous. Là où le bât blesse, mettons les pieds dans le plat, c'est que Benjamin Millepied est aussi piètre chorégraphe qu'il s'annonce bon directeur de la danse. Je suis tout à fait d'accord avec lui (comme sur à peu près tout ce qu'il a dit) qu'il y a actuellement peu de bons chorégraphes classiques ; il n'en fait hélas pas partie. Certes, il connaît bien le vocabulaire classique, qu'il utilise assez largement, travaille le pas de deux en artisan et invente des combinaisons charmantes, mais son travail n'est absolument pas musical. On peut se moquer de Noureev et de son « un pas sur chaque note » ; Benjamin Millepied, c'est trois pas entre deux notes. Chez Wayne McGregor, au moins, la précipitation, alliée à l’extrémisme de la gestuelle, porte une certaine fougue et même, la première fois, éblouit. Chez Benjamin Millepied, la précipitation verse dans la lenteur – c'est du pareil au même quand la musique doit se charger seule d'indiquer le changement d'atmosphère ; adage ou allegro, qu'importe, tout est égal. Le directeur peut chorégraphier sur ses deux oreilles ; danse et musique font chambre à part. Résultat, lors de cette séance de travail, j'ai peiné à voir une différence entre le début et la fin de la répétition, alors qu'il y a d'ordinaire un avant/après très net et que les danseurs n'ont pas ménagé leur peine pour intégrer les corrections. Au final, malgré la présence souriante très sympathique de Marion Barbeau et Yvon Demol, cette séance de travail aura été plus intéressante pour ce qui a été dit par le directeur de la danse que fait par le chorégraphe. Pas parler, faire, répétait Noureev...
18:48 Publié dans Souris d'Opéra | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danse, ballet, bastille, répétition, benjamin millepied
10 septembre 2015
Ingrédients explosifs
Pour faire un Mission impossible, vous avez besoin de...
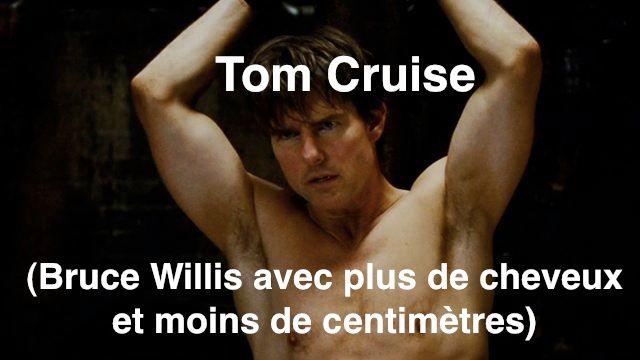
(parce qu'il n'y a pas que la taille qui compte)

(tout est dans la lunette)

(option cascade serait un plus)

(parce que l'IMA, ce n'est pas du pipeau)

(parce que)

(obviously)

(Et pigeon vole !)
(Et spectateur se marre.)
22:30 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : film, cinéma, mission impossible, tom cruise
08 septembre 2015
Miss Hokusai
On pourrait dire que Miss Hokusai est l'histoire d'O-Ei, l'une des filles d'Hokusai, avec laquelle il a peint à quatre mains, mais ce ne serait pas tout à fait exact. Keiichi Hara raconte moins une histoire qu'il se complaît dans une évocation historique et surtout esthétique, en témoignent les clins d'oeil aux tableaux les plus célèbres du peintre : le cou extensible d'une geisha qui invite O-Ei à la peindre rappelle l'estampe du spectre aux assiettes ; Hokusai exécute le dragon commandé par un riche client ; et il faut bien une immense vague pour traduire le plaisir des remous ressentis par la petite sœur aveugle d'O-Ei lors d'une promenade en barque.
Au-delà de ces références directes, on s'immerge avec plaisir dans l'Edo (aujourd'hui Tokyo) du début du XIXe siècle1, charmé par le mélange de poésie, de prosaïsme et d'onirisme avec lequel le quotidien est croqué. Sous l'oeil du maître, on apprend, avec les autres disciples, à voir : la neige qui dégringole des arbres, le fantastique dans le quotidien, la sérénité de trois paires de sandales alignées, mais aussi les émois retenus d'O-Ei, le respect qu'elle a pour son maître et le ressentiment qu'elle nourrit envers un père qui se rend plus aveugle que sa fille condamnée à la cécité. Sans Hokusai, pas de Miss Hokusai et pourtant, ce n'est pas là que réside l'intérêt de l'animé. Si on nous montre O-Ei vivant dans l'ombre de son père, c'est moins comme une disciple qui n'aurait pas eu la reconnaissance qu'elle mérite2, que comme une jeune femme qui ne se décide pas à embrasser ses faiblesses. Plus qu'un portrait d'artiste, au final, c'est un portrait de femme, paradoxale, à la fois dotée d'un caractère bien trempé et fidèle servante de la tradition, sociale et artistique, représentée par son père.
Mit Palpatine
1 L'animé est adapté d'un manga historique d'Hinako Sugiura.
2 J'ai même lu le mot de « jalousie » et me demande dans quelle mesure ce n'est pas dicté par notre regard occidental qui méconnaît la relation maître-disciple, ou plutôt (si on veut bien penser aux ateliers de la Renaissance comme le rappelle Keiichi Hara en interview) l'envisage sous l'angle de la rivalité davantage que celui de l'émulation.
22:04 Publié dans Souris de médiathèque | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, hokusai























